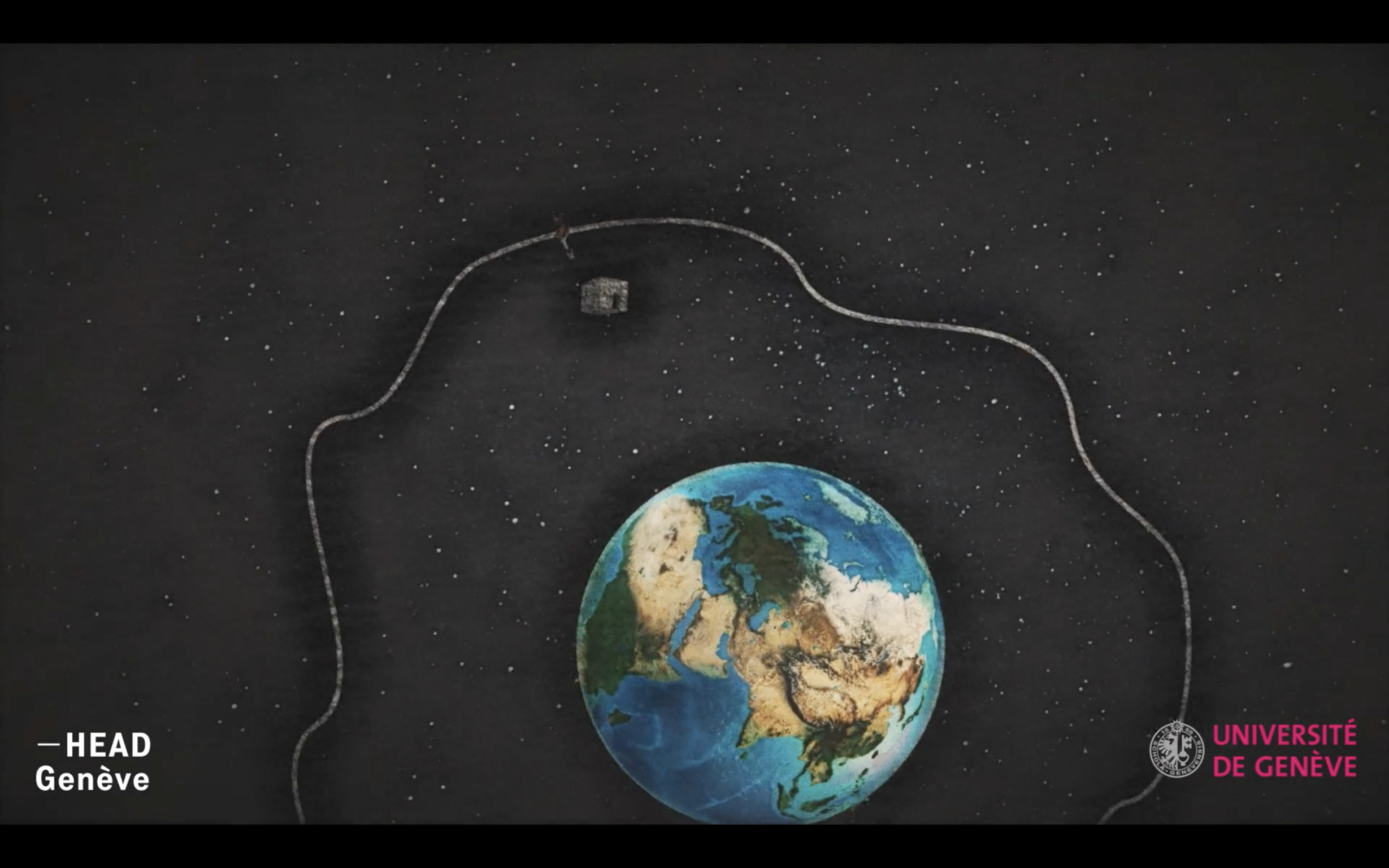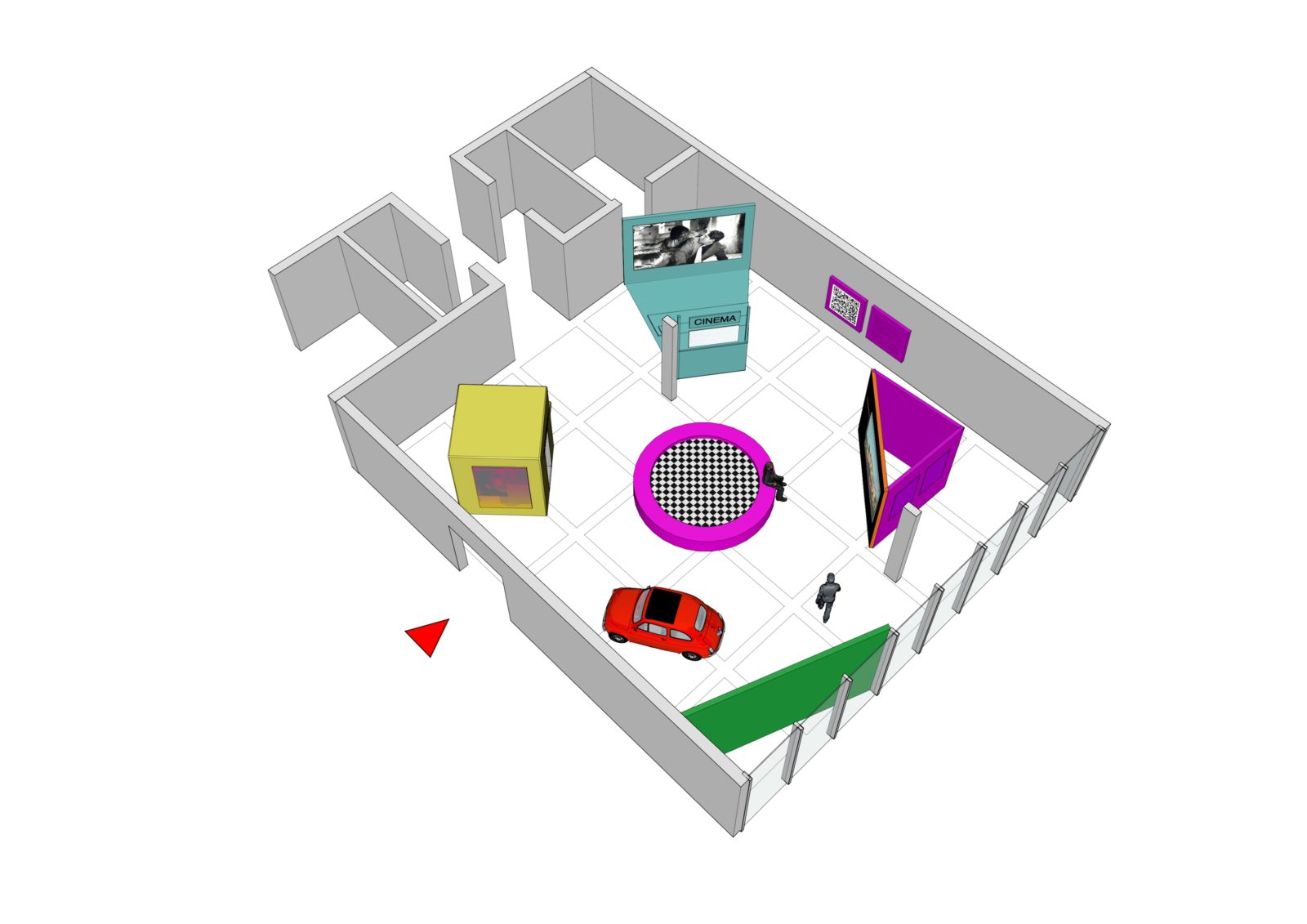Voyage enchanté avec Bongo Joe Records
Entretien avec Quentin Pilet (Bongo Joe Records) par Raphaël Pieroni
Texte
Raphaël Pieroni : Merci Quentin de nous accueillir aujourd’hui à Bongo Joe Records, au cœur de la ville de Genève. Lieu désormais incontournable de la scène culturelle et musicale genevoise et dans lequel nous avons verni nos trois ouvrages collectifs consacrés aux rapports entre musique et géographie : Monde / Villes / Voyage enchanté publiés aux éditions Georg (2021, 2022, 2024). Tu co-gères le label du même nom avec Cyril Yeterian et Juliette Gérard, et on est ensemble pour discuter chansons et géographie. Avant cela, tu nous en dis un peu sur ton travail et votre structure ?
Quentin Pilet : Le label Bongo Joe va avoir neuf ans au mois de novembre prochain, et en neuf ans on n’a pas chômé. Le catalogue compte plus de cent sorties, c’est assez conséquent pour un label de petite taille. On est trois à gérer la vie quotidienne du label, ce qui rend les choses parfois compliquées, il y a toujours trop de boulot [rire].
Notre travail, c’est de sortir de la musique, sur vinyle bien sûr, mais aussi en digital, en CD et même en cassette. Tout débute lorsqu’un artiste a enregistré un projet et souhaite le voir publier. On l’accompagne dans cette démarche pour voir la musique diffusée le plus largement possible.
R.P. : Comme tu le sais, le projet de la géographie enchantée, c’est de faire le lien entre musique et lieux. Pour cela, on a sélectionné des morceaux très connus, tout du moins du public francophone. Le fait qu’ils soient très connus les rend intéressants pour l’étude des imaginaires géographiques qu’ils véhiculent auprès du grand public. Vous c’est peut-être moins le cas, vous cherchez à sortir de la musique de niche, connue de peu de personnes, non ?
Q.P. : Je pense que l’idée du label n’est pas de faire dans la niche et dans une certaine forme d’élitisme à tout prix. On sort avant tout de la musique qui nous touche et surtout qu’on souhaite faire découvrir. C’est pour ça que le catalogue est si varié. On peut sortir du punk argentin, de la pop bien genevoise, des morceaux oubliés dans les sous-sols de la radio nationale de Sao Tomé-et-Principe ou de l’électro-rock turc.
Pour présenter notre travail, je diviserais nos sorties en trois catégories. D’un côté, il y a la réédition. On fouille dans les tréfonds de la grande histoire de la musique pour ressortir des titres oubliés. C’est un travail compliqué, car souvent il s’agit de musique non occidentale. On cherche donc à y mettre de l’éthique et ne pas s’approprier bêtement une culture qui ne nous appartient pas. Dans ce registre, on a sorti de la sega mauricienne, des instrumentaux de guitare azéri ou du post-punk espagnol de la fin du franquisme. L’idée est de faire réémerger un patrimoine ; on ne découvre rien, ces morceaux existent, sont connus par les communautés, on est de simples passeurs.
Ensuite on sort de la musique actuelle. Des artistes internationaux d’abord, issus des grandes villes du monde, Istanbul, Bogotá, Londres, Berlin, Amsterdam, ou de pays qui ne figurent pas forcément sur la carte de l’industrie musicale classique, Haïti, le Malawi ou le Mali. On sort de tout tant que ça nous plaît. Ces groupes, ce sont surtout des ami·exs, des gens rencontrés sur la route, des connaissances de connaissances. On évite de signer des artistes avec qui on n’entretient pas une réelle relation. C’est important pour nous de développer un certain esprit familial.
Finalement, on est aussi ancré·es dans la scène genevoise, romande et suisse. L’idée est de servir de tremplin ou en tout cas de véhicule pour diffuser un maximum des artistes émergent·exs basé·exs ici. C’est notre rôle d’acteur culturel local. Lancer des jeunes, les accompagner dans leur professionnalisation. Personnellement, je le vois comme un devoir.
R.P. : C’est bien que tu me parles de ça. Tu sais que dans notre projet, Genève occupe une place importante puisqu’on est basé·es ici évidemment. On a retenu des titres comme Genève… ou bien de Marie Laforêt ou Genève de Marekage Streetz et analysé quels imaginaires de Genève ces chansons participaient à véhiculer. Peu de gens connaissent les chansons sur Genève, la ville n’est pas une machine à tubes on va dire…mais selon toi comment elle se porte cette ville musicalement, qu’est-ce que tu peux nous en dire ?
Q.P. : Je crois qu’avant tout, on en est fier·es de cette ville. C’est une scène assez unique sur le plan européen, avec énormément de lieux, énormément de groupes. C’est un vivier d’associations, de collectifs, d’activistes. Pour la taille de la ville, c’est assez étonnant, quand on compare ça à d’autres bassins de population similaire.
Bongo Joe s’inscrit vraiment dans la tradition de ce qu’est la culture alternative genevoise. Historiquement, Genève c’est la ville des squats. La légende veut qu’à une période ce fût la ville la plus squattée d’Europe. Même si tout ou presque a été fermé entre la fin des années 1990 et les années 2010, il y a toujours quelque chose qui infuse dans la scène. Ce côté punk, DIY, politiquement engagé, est un marqueur identitaire assez fort.
Ensuite, il y a bien sûr le fait que Genève est une ville d’immigration. Les diasporas se mélangent, les sonorités aussi. Cela se sent dans ce qui est joué dans les clubs et dans ce qui est produit ici. On a des sons des quatre coins du monde, les oreilles sont habituées à écouter de tout.
À l’image des rappeurs qui citent Genève dans leur morceau, on est assez fier·es de porter le maillot genevois dans le paysage mondial et ce qu’elle représente pour nous, loin de l’image blingbling des montres et du trading à haute vitesse. Lancer des groupes ultra-locaux qui s’inscrivent dans cette veine et leur donner une certaine envergure internationale, c’est un beau pied de nez à l’image proprette et policée de Genève que certains veulent véhiculer.
R.P. : Comme tu le dis, Genève fait partie des villes les plus riches du monde. Elle reste une ville très polarisée avec des populations aux provenances très variées. Il y a évidemment des super-riches, des expats, des gens qui galèrent, une classe moyenne parmi les plus aisées du monde, et là-dedans surnage cette scène alternative. Mais cette scène est souvent cachée, un peu secrète, peu accessible, notamment pour de nouveaux arrivant·exs.
Q.P. : Comme on aime à le dire, on est les cafards de cette ville [rire]. La scène est souterraine, parfois peu valorisée, et comme dans n’importe quel milieu de ce type, il y a peut-être un certain repli. Mais c’est aussi pour réussir à cultiver un sens de la solidarité, d’entraide. La ville est petite, le public n’est pas infini, du coup il n’est pas possible de se tirer dans les pattes, on doit faire ensemble. Les scènes se côtoient, se mélangent. On passe d’une soirée punk à une soirée dub en deux coups de pédales. C’est ça aussi qui fait la force de cette scène. Certes elle n’est pas accessible, mais quand on met un pied dedans on a de la peine à s’en sortir.

Crédit photo : Ambre
R.P. : Pour l’occasion, tu nous as composé un mur de vinyles un peu spécial. Toutes les pochettes ont un lien avec la géographie. D’un coup d’œil, on voit se dessiner un lien entre musique et visuel, concept sonore et représentation. Tu peux nous en dire plus sur ta démarche ?
Q.P. : Je me suis principalement concentré sur les pochettes. Avec trente mille disques dans le magasin, j’ai eu de la peine à chercher dans le contenu pour sortir des morceaux précis liés à la géographie. Mais les pochettes sont vraiment signifiantes. Quand tu conceptualises un projet musical, il y a forcément le passage par la case illustration. Elle incarne visuellement l’identité de la musique.
Dans la sélection, on peut déceler plusieurs axes. Le premier, celui des représentations fantasmées de l’ailleurs : l’oasis, les vacances, le voyage. Le deuxième, les représentations paysagères, contemplatives et souvent photographiques : la mer, les montagnes, les déserts. Le troisième, la ville, souvent en noir et blanc, comme une prison de béton. Il y a aussi des cartes, mappemondes, représentations du globe. Chacun de ces axes est décliné, mais s’inscrit souvent dans un genre musical. Le désert, c’est du blues ; la ville c’est du punk ; les cartes ce sont plutôt des compilations de musique d’un peu partout, etc.
R.P. : Je vois aussi qu’il y a pas mal de représentations de routes. Le roadtrip c’est vraiment un marqueur fort dans l’histoire de la musique.
Q.P. : Il y a effectivement un rapport assez intéressant entre la route et la musique. Les musicien·nexs sont finalement assez nomades. La tournée est un mode de vie. Passer de ville en ville, souvent en camion, c’est le gros de la carrière d’un groupe. Du coup, la route participe à l’imaginaire du musicien, de la musicienne. On trace, souvent pendant des heures, surtout dans des pays comme les États-Unis où tu fais neuf heures entre deux villes ! Il y a pas mal d’albums que je considère comme des albums d’autoroute. Un bon exemple, c’est Autobahn de Kraftwerk, c’est vraiment la transcription sonore de ce que fait un trajet en voiture : rapide, linéaire, cosmique. L’autoroute, c’était la modernité, et la musique de Kraftwerk, électronique, est une trame parfaite pour transmettre ce sentiment de vitesse, avec ce rythme krautrock spécifique.
R.P. : On travaille aussi sur la musique comme un véhicule émotionnel. Finalement, la musique offre un voyage parfois intérieur, mental. C’est quelque chose qui te parle ?
Q.P. : Comme tout le monde, j’ai mes morceaux tire-larmes, sur lesquels je finis mes peines de coeur (rire). Mais plus sérieusement, en travaillant dans la musique, on ne fait plus que ça : écouter, écouter, écouter. Et là où je me surprends peut-être, c’est que je ne me lasse pas. J’ai beau écouter du son à longueur de journée, il y aura toujours des morceaux qui résonnent, qui me procurent des sentiments forts. L’euphorie de découvrir une nouvelle chanson, qui te brasse d’une manière ou d’une autre, c’est un sentiment génial.
R.P. : Pour conclure cet entretien, est-ce que tu nous recommandes un album « géographique » que tu considères comme un vecteur, une sorte de véhicule pour voyager.
Q.P. : Si je ne devais en choisir qu’un, ce serait Monochrome de Minako Yoshida. C’est une chanteuse japonaise de la fin des années 1970 et des années 1980. Sur cet album, on a la quintessence de ce qu’est la City Pop, soit la disco japonaise 80s. Comme moyen de transport vers une autre époque avec des synthés cheesy, une utilisation avant-gardiste des boîtes à rythmes qui sonnent désormais complètement datées. Tu voyages dans le temps, et dans l’espace parce que tout est chanté en japonais, et quand tu fermes les yeux tu as vraiment des images d’un Tokyo rétrofuturiste qui n’a probablement jamais existé.

 Retour au sommaire
Retour au sommaire