Paysages déshydratés
Texte
Falo somente do que falo:
do seco e de suas paisagens,
Nordestes, debaixo de um sol
ali do mais quente vinagre:
que reduz tudo ao espinhaço,…
(João Cabral de Melo Neto)1
Si vous lisez ce texte sur un écran d’ordinateur, il est possible que vos yeux s’assèchent. L’exposition prolongée à des écrans électroniques lumineux fait que nous clignons moins des yeux et que la lubrification se réduit, ce qui peut entraîner un état connu sous le nom de « sécheresse oculaire », provoquant une gêne et affectant gravement notre vision. Alors que nos globes oculaires se déshydratent devant les écrans, on estime qu’environ 33% du globe terrestre subit actuellement des processus d’aridification. Outre le réchauffement climatique, la cause la plus immédiate de l’aridification dans le monde est l’utilisation inappropriée des terres par l’élevage et l’agriculture conventionnels.
En réfléchissant à ce double diagnostic sur la relation entre ce que nous produisons pour manger et ce que nous voyons, le thème de la déshydratation m’est apparu comme une question d’une grande actualité. Cependant, peut-être même de manière subversive, à côté du sens négatif de la sécheresse, qui dénote ces états contemporains d’épuisement, un autre sens m’est apparu. En la replaçant dans cet autre contexte, notamment sur le plan esthétique et/ou existentiel, l’aridité est devenue un état désiré, qui consiste en un processus mental soustractif pour arriver au vital. Citant Deleuze, le philosophe David Lapoujade affirme que « réduire, pour Deleuze, c’est désertifier, c’est-à-dire renvoyer la matière et la pensée à un monde d’avant et d’après l’homme, pour en explorer les puissances »2. Au Brésil, le poète João Cabral a fait toute sa carrière en s’intéressant à ce point paradoxal entre une réalité sociale sèche et tragique, de manque, de soustraction et de besoin de soins et de provisions, et une « poésie du moins »3, assumée et désirée pour l’œuvre elle-même.
L’ouverture vers cette deuxième conception de la sécheresse s’est faite pour moi en 2017, lorsque j’ai été invité à réaliser un projet à la résidence d’artistes du Sandhills Institute, qui se trouve dans une petite ville appelée Rushville dans l’État du Nebraska, aux États-Unis. Cette région est essentiellement rurale et largement monoculturelle. Grâce à une technique appelée irrigation par pivot, les zones sont cultivées sous forme d’immenses cercles qui créent des motifs graphiques dans le paysage, si grands qu’ils peuvent être vus d’avion.
Depuis 2014, date à laquelle je me suis consacré à une recherche postdoctorale à Florianópolis, au Brésil, sur la relation entre l’agroécologie et les pratiques artistiques site specific, j’étudie l’utilisation des terres et les interventions humaines dans le paysage qui ont lieu au-delà du champ de l’art, ou du land art. Parmi ces utilisations, je me suis particulièrement intéressé à l’impact environnemental de l’agriculture moderne et aux modes alternatifs de production alimentaire qui sont alignés sur l’écologie ou l’agroécologie. Comme pour les pratiques artistiques site specific, les modes de production agroécologiques s’exercent généralement en dialogue avec les spécificités locales, qui jouent un rôle décisif et guident les interventions dans le paysage ou, dans le cas présent, les modes de culture.
En arrivant à la résidence de Rushville, j’ai rapidement remarqué que dans les environs de la maison où je logeais, il y avait une plante qui poussait en abondance. En l’examinant, j’ai découvert qu’il s’agissait d’Urtica dioica, plus connue sous le nom d’ortie. Jusqu’alors, j’ignorais ses propriétés nutritionnelles. Au Brésil, où je vivais alors, les orties font partie d’un groupe de plantes qui ont été, comme le suggère Valdely Kinupp, appelées PANC – Plantas Alimentícias Não-convencionais, ce qui, traduit en français, serait « des plantes comestibles non conventionnelles »4. Craignant les dommages qu’elles pourraient créer à la peau humaine, les orties sont souvent évitées, et donc ignorées, en tant que riche source de nourriture. Peu de gens savent que sa composante agressive est éliminée à la cuisson ou à la déshydratation.
Il m’a semblé intéressant de consacrer la période de ma résidence au Sandhills Institute à créer une relation avec cette plante spontanée, d’autant plus qu’il s’agissait d’une région où tout le rapport aux plantes est planifié et monoculturel. Cependant, plus que d’isoler l’ortie comme objet d’étude, il m’intéressait de la penser dans un espace situé et animé par son énergie vitale, comme témoin de processus écologiques, et, ainsi, comme « médiateur dans la relation société-environnement »5. Contrairement aux plantes cultivées, qui nécessitent souvent que le sol soit « corrigé » pour que la culture choisie puisse prospérer, les plantes spontanées établissent une relation intensive avec un lieu particulier. En réalité, ce sont les conditions locales qui favorisent leur arrivée, et leur vie se développe en réponse aux spécificités du lieu. Leurs graines peuvent souvent être transportées par les oiseaux ou le vent ; l’irrigation dépend quant à elle des cycles pluviométriques et de l’humidité locale.
L’apparition d’une plante dite spontanée dépend d’une série de négociations entre espèces et facteurs environnementaux, ce qui permet de dire que cette vie est porteuse d’une capacité dialogique, exercée entre des êtres multiples et la complexité qui les constitue. C’est ainsi qu’un comestible sauvage peut germer dans des endroits aussi divers que dans des fissures de bois ou entre des rochers. On pourrait dire qu’un tel mode d’existence, qui se déroule indépendamment du désir humain, contraste fortement avec celui de l’agriculture moderne. En isolant une plante, en corrigeant le sol pour qu’une espèce particulière prospère, en recourant à l’irrigation, aux pesticides et aux machines lourdes, nous devenons les dictateurs de ce qu’une localité particulière doit produire, en ignorant souvent les spécificités locales et en inversant la dynamique de la vie établie de longue date : ainsi, toutes les espèces qui y prospéraient sont désormais considérées comme « invasives », ou « mauvaises herbes ». Ce mode d’action colonisateur, centré sur l’imposition du désir humain à des écosystèmes entiers, dévaste et simplifie la biodiversité au nom de monocultures qui visent la surproduction et la marchandisation, et qui ne profitent qu’à quelques humains. Pour l’anthropologue Anna Tsing, le mode de culture monoculturel opère par la coercition, en supprimant la romance qui relie habituellement « les plantes, les gens et les lieux »6.
Le choix de l’ortie comme espèce compagne de mon travail, dans le cadre de la résidence que j’ai réalisée en 2017, a fait appel à des modes de relation qui ne concernaient pas seulement la recherche de ses caractéristiques visuelles ou physiologiques. Puisque les orties sont destinées à la consommation, le système digestif a également été convoqué : j’ai imaginé les microvillosités intestinales comme des « tentacules »7 qui investiguent, touchent et, de cette manière, se connectent au paysage environnant. Ainsi, avec les personnes qui m’accompagnaient dans le projet, nous avons préparé des infusions, des vitamines et des soupes, qui incluaient des orties, cherchant à expérimenter, reconnaître et écouter les histoires de ce lieu à travers cette plante. Le système digestif, en décomposant les aliments que nous portons à notre bouche, déballe également des informations ; les histoires et les relations établies par cette plante avec d’autres êtres, avec le soleil, avec l’humidité du sol, avec les étoiles, et avec les différentes températures auxquelles elle a été exposée. Nos tripes deviennent ainsi un instrument de lecture, une manière d’expérimenter et de naviguer à la surface de la terre à travers la nourriture qu’elle produit. La végétation spontanée est un document vivant, une photographie photosynthétique d’un lieu particulier qui, lorsqu’elle est comestible, peut être vue non seulement par nos yeux, mais aussi par toutes les cellules de notre corps qui participent à son métabolisme. Parce qu’ils n’ont pas été cultivés, ces aliments nous parviennent comme des cadeaux, des produits de relations et d’écosystèmes locaux, qui nourrissent notre corps de leçons d’interdépendance, d’appartenance et de complexité.
L’expérimentation des différents modes de consommation de l’ortie, et la compréhension de cette plante comme portrait photosynthétique d’un certain lieu m’ont amené à expérimenter divers processus de déshydratation. Profitant de l’été chaud et sec de Rushville, nous avons suspendu des fagots d’orties dans un hangar pour les laisser sécher. Ensuite, nous avons séparé les branches des feuilles, et les avons mixées jusqu’à ce qu’elles se transforment en une fine poudre vert foncé. Nous avons conditionné ce farofa8 dans de petits pots, qui ont reçu des étiquettes réalisées par les étudiant·e·x·s en art et les stagiaires de la résidence. Les orties, qui étaient désormais transportables, constituaient une sorte de non-site9 comestible de cette localité, qui pouvait désormais intéresser d’autres palais dans d’autres localités, poursuivant ainsi un processus de relation entre les corps et les paysages, que j’ai appelé « médiation cellulaire ».
De retour à Rio de Janeiro, la ville où je vivais à l’époque, j’ai mélangé la poudre verte à une pâte à pain. En la savourant, je me suis souvenu de mon séjour à l’Institut Sandhills dans une métabolisation continue de ce lieu et de ses histoires ; non seulement humaines – impliquant mon séjour et ses réminiscences – mais aussi non humaines, englobant d’autres temporalités que je n’avais pas vécues ou ressenties, mais qui étaient maintenant présentes : le dialogue des orties avec l’air et les vents, avec les différents rythmes des saisons et la vibration moléculaire du sol, l’interaction avec d’autres espèces.





En réfléchissant et en reprenant la recherche sur les orties quelques années plus tard, en 2021, la déshydratation s’est insinuée cette fois non pas dans le cadre de l’élaboration d’une œuvre, mais comme motif d’une recherche collaborative plus large, que j’ai développée avec l’artiste et photographe Pedro Leal. La déshydratation comme moyen de réduire le paysage, de le livrer de manière abrégée pour qu’il soit plus tard réhydraté ; cela nous a finalement semblé être une métaphore de divers processus de création et de communication esthétiques. Par exemple, la page du livre, qui contient, dans sa matérialité, l’encre de l’impression déshydratée, lorsqu’elle est lue par le lecteur, est en quelque sorte réhydratée par le contenu. Une peinture qui, en séchant, stabilise une image, peut, quant à elle, être ravivée par celleux qui la contemplent.
Cependant, avec le temps, l’aridification s’est imposée à nous, non seulement comme une méthode pour réduire et créer des extensions d’un lieu spécifique, mais aussi comme une condition de certains lieux, tels que ceux mentionnés plus haut. Comme nous nous intéressons à la relation entre ce que nous mangeons et le paysage, prendre les lieux arides comme thème nous a semblé être une voie de recherche passionnante. L’évocation la plus immédiate de ce terme est sans doute celle des déserts du Sahara et de l’Atacama. Les raisons de leur existence relèvent surtout de causes géologiques. Par ailleurs, il existe des régions qui, sans être des déserts, sont parfois la cible de processus d’assèchement, avec des effets néfastes pour les populations locales, comme les sécheresses saisonnières dans la région du nord-est du Brésil, qui entraînent une forte mortalité des plantes, des animaux et des hommes ; et celles qui se produisent dans l’État de Californie, aux États-Unis, dont les résultats alarmants sont les incendies qui touchent les forêts et les habitations.
À côté des régions définitivement ou temporairement sèches, il existe également des processus appelés aridification, qui désignent l’avancée de la sécheresse dans certains endroits, souvent de manière définitive et irrémédiable. Plus qu’un simple appauvrissement des sols, l’aridification crée un processus complexe d’appauvrissement des populations locales, générant des conflits politiques, de la misère et l’exode des régions touchées. L’aridification, qui découle en grande partie des méthodes prédatrices de culture des aliments, peut conduire à la précarisation de nos systèmes alimentaires. La prédominance d’une production alimentaire régie par de grandes marques mondialisées annihile ou affaiblit les formes locales de production alimentaire, empêchant la consommation d’une diversité d’aliments et de sources nutritionnelles, tout en transformant des paysages entiers (avant même qu’ils ne soient touchés par l’épuisement des ressources) en déserts verts, qui ont, eux, un impact sur l’ensemble de sa sociobiodiversité. La sécheresse oculaire, ou œil sec, désigne une autre forme de précarité : celle de la captation ingénieuse de notre attention pour un usage quasi obsessionnel des appareils électroniques que sont les téléphones portables et les écrans d’ordinateur. Cette fois, c’est notre capacité à voir et à faire sens de la réalité qui est compromise, et nos yeux secs s’imposent comme un signe de cette immersion vertigineuse. À mesure que le globe terrestre se dessèche, notre perception de la réalité et notre capacité à répondre aux urgences et même aux plaisirs du monde se déshydratent également.
Les paysages déshydratés cherchent à inaugurer des façons d’aborder les processus d’aridification, afin de créer des possibilités de répondre aux urgences du scénario dans lequel la crise environnementale progresse et menace divers modes de vie sur notre planète. L’appréhension de ce sujet présente toutefois de multiples complexités. L’aridification entre dans la catégorie de ce que l’auteur Timothy Morton appelle les hyperobjets, c’est-à-dire les choses dont la réalité défie les habitudes les plus immédiates de l’appréhension humaine.10 Les hyperobjets ont une matérialité impalpable, ils ne peuvent être pointés ou localisés, mais leurs effets, étendus dans des espace-temps dilatés et imprévisibles, sont concrets. La théorie des hyperobjets s’inscrit notamment dans une analyse du réchauffement climatique, mais convoque aussi d’autres « entités » dont l’existence est liée à l’épuisement des ressources de la planète. Outre le parallèle établi entre le dessèchement des orties et la compréhension du processus artistique dans Urtica Dioica, c’est aussi par une question de méthode que s’impose cette nouvelle étape de la recherche. Comment de nouvelles formes de représentation sont-elles possibles pour appréhender la complexité de la crise environnementale ? Comment l’aborder, la rendre palpable et y répondre ? Quel est le rôle de l’art et des artistes dans ce processus ? Quels sont les effets de la sécheresse sur le langage et les autres formes de matérialisation, telles que les images photographiques ? La déshydratation de la pensée et du langage serait-elle également un moyen de discuter des complexités inhérentes à l’aridification ? Et si oui, à quoi cela ressemblerait-il, comment ressentirions-nous cela, et quel goût cela aurait-il ?
Étant donné l’appréhension difficile qui les caractérisent, les hyperobjets sont souvent confrontés au négationnisme, qui tente de minimiser et d’éliminer le besoin de les reconnaître. C’est pour cette raison que faire face à la menace qu’ils représentent dépend essentiellement d’une affirmation de la réalité, intensifiant son existence à travers des modes de représentation qui peuvent nécessiter de nouvelles images et un nouveau langage. « Si un paysage n’est pas décrit, il n’est pas soigné », affirme l’écocritique David Farrier11. Notre capacité à prendre soin de la vie est liée à notre capacité à la percevoir. Les arts de l’observation, tels qu’ils sont abordés par Anna Tsing, sont donc convoqués dans le débat sur l’environnement comme une pièce maîtresse. En effet, selon Farrier, « la crise environnementale est aussi une crise de sens »12. En permettant la création d’images et de langages qui s’entrelacent avec le phénomène complexe de l’aridification, Dehydrated Landscapes vise à réhydrater notre vision, en même temps qu’il irrigue notre capacité de réponse.

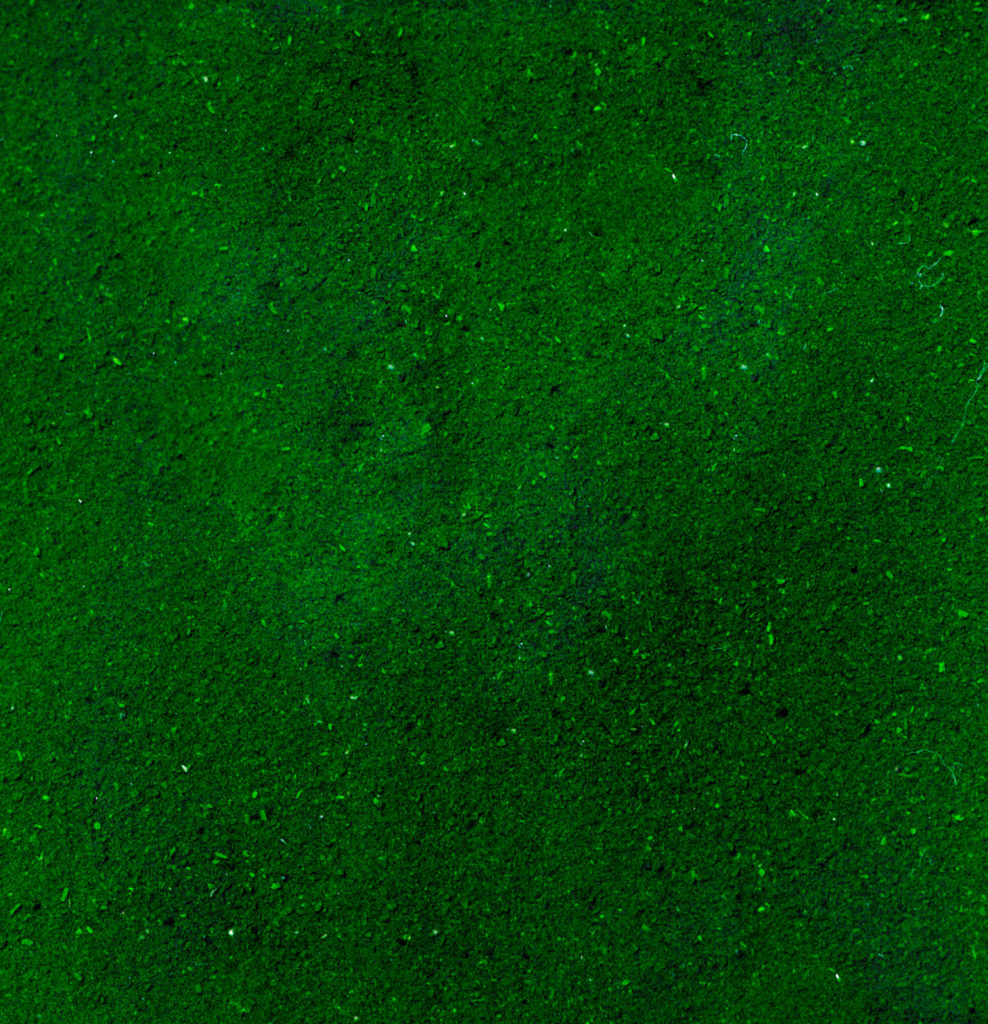
Notes
- João Cabral de Melo Neto, Obra completa: volume único, Marly de Oliveira (dir.), Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1994, p. 311-312. « Je ne parle que de ce dont je parle:/ du sec et de ses paysages,/ Nord-Est, sous un soleil/ là du vinaigre le plus chaud :/qui réduit tout à l’épine dorsale,… », notre traduction. Les traductions suivantes sont les nôtres également.
- David Lapoujade, As Existências Mínimas, São Paulo, n-1 edições, 2017, p. 55.
- Antonio Carlos Secchin, João Cabral: Poesia do Menos, São Paulo, Duas Cidades, 1985.
- Valdely Kinupp, PANC: Plantas Alimentícias Não-convencionais, São Paulo, Ed. Plantarum, 2014.
- Regiane Fonini et José Edmilson de Souza Lima, « Agrofloresta e alimentação: o alimento como mediador da relação sociedade-ambiente », dans Walter Steenbock (dir.), Agrofloresta, Ecologia e Sociedade, Paraná, Ed. Kairós, 2013, p. 197.
- Anna Tsing, « Unruly Edges: Mushrooms as Companion Species », Environmental Humanities, vol. 1, 2012, p. 148, https://www.environmentandsociety.org/sites/default/files/key_docs/eh_1.9_tsing.pdf (dernier accès le 25.2.2022).
- Donna Haraway, Staying with the Trouble, Durham, Duke University Press, 2016, p. 71.
- Met d’accompagnement brésilien servi sous la forme de poudre, souvent confectionné à partir de farine de manioc, maïs, quinoa ou blé.
- En référence à la distinction entre site et non-site opérée par Robert Smithson.
- Timothy Morton, Hyperobjects: Philosophy and Ecology after the End of the World, Minnesota, University of Minnesota Press, 2013.
- David Farrier, Anthropocene Poetics: Deep Time, Sacrifice Zones, and Extinction, Minnesota, University of Minnesota Press, 2019, p. 4.
- Ibid.

 Retour au sommaire
Retour au sommaire 

