Abstract
Upon entering his final year as Head of Visual Arts in September of 2017, Yann Chateigné addressed some of the key principles he had learnt during his eight years in the department. Totally foreign to teaching, Chateigné had immersed himself in this new experience and, in this transcription of his lecture, he lists the methods he invented in ten fragments, akin to logbook entries for unknown territory. Far from any classic pedagogical textbook, his words, which have been slightly edited for this written version, draw inspiration from the work of anthropologists, neurobiologists and philosophers. As a result, Chateigné was able to think in terms of relationships and organisations that are non-authoritarian, and which support the flow of ideas and welcome difference in order to allow the unexpected to express itself.
Text
L’enseignement par le milieu articule deux formes de savoirs : un savoir constitué, qui représente la somme d’expériences, de connaissances et de savoir-faire que l’enseignant emporte avec lui à l’intérieur du système pédagogique, et un non-savoir, qui est tout aussi important. Ce non-savoir s’incarne de diverses manières dans le dispositif de l’école, que ce soit dans la capacité de l’institution à accueillir des individus qui enseignent souvent pour la première fois et engagent ainsi instinctivement des processus pédagogiques constituant autant de singularités, ou dans la capacité de l’enseignant plus expérimenté à s’engager dans une forme de non-savoir nécessaire à l’accueil, au sein de la structure, des formes de nouveauté venant cette fois-ci du côté des enseignés. C’est sur cette double distance face à l’idée de formation, de conditionnement par la reproduction, que repose l’échange pédagogique horizontal nécessaire à l’équilibre d’un système de transmission dynamique. Il est par ailleurs le reflet des formes spécifiques de savoirs que charrient les œuvres des artistes : si elles sont parfois nourries de recherches, chargées d’informations de toutes sortes, inscrites elles-mêmes dans un réseau d’échanges, sujettes à une myriade de productions de données, les productions artistiques ne sont pas pour autant uniquement des vecteurs, des médiations de savoir, transparents ; leur spécificité est de résider dans un espace en suspension, au sein duquel savoir et non-savoir se rencontrent, sans pour autant s’opposer. Cette relation singulière qu’entretient l’art avec la connaissance s’origine dans une méthode, voire une contre-méthode, dans une manière de chercher à l’encontre de la volonté de « production de forme de savoir arachnéen, c’est-à-dire qui se forme entre d’autres espaces. Il est cristallin, se constitue de proche en proche, est fait de liens. Il est complexe, et à l’organisation de l’expérience, il associe la dérive, à l’observation, la perte, à la structure, le mouvement libre, oblique, ambulant, dans l’espace du savoir. La connaissance par le milieu se matérialise dans la complexité intelligente d’un lieu organique, qui autorise une relation de l’art à une forme de recherche de la vérité, sans pour autant reposer sur un plan écrit d’avance : il funambule sur la ligne ténue qui sépare l’ordre et le chaos du laboratoire, le chemin et la sérendipité de la recherche véritable, la logique et le désir désordonné du philosophe, seule manière à même de percer le secret d’un monde lui-même désorganisé.
*
Gilles Deleuze aimait à répéter que l’herbe pousse au milieu, et par le milieu dans le sens où elle participe et se nourrit dans le même temps du milieu, de son environnement. Elle croît littéralement par son centre, non pas du bas vers le haut, mais dans tous les sens, à chaque instant. C’est cette image que reprend Emanuele Coccia lorsque, dans La vie des plantes, il évoque la fonction cosmique des arbres, au sens littéral du terme : la croissance des végétaux est mue par une force énigmatique qui les engage à s’enraciner sans cesse au plus profond dans la terre, notre planète, tout en faisant pousser leurs branches et leurs feuilles vers les astres. Selon le philosophe, qui a élaboré de superbes « théorie de la feuille » ou « théorie des racines », ce sont les arbres, et non pas les hommes, qui font silencieusement le lien constant avec le cosmos. L’anthropologue Eduardo Kohn pense également, après avoir observé durant plusieurs années les pratiques de populations d’Amazonie qu’il y a bien une « pensée de la forêt », qui s’organise dans la relation en tous sens entre les humains et la multiplicité des non-humains qui la peuplent. Enseigner par le milieu est ainsi être une manière de penser l’école comme un environnement, contre toute forme de spécisme, milieu au sein duquel la différence entre les êtres est la condition première de la relation. Le « multinaturalisme » que décrit l’anthropologue Edoardo Viveiros de Castro dans ses études de la culture des sociétés traditionnelles au Brésil est à ce titre des plus inspirants pour penser un modèle pédagogique fondé sur la « différence infinie » dont parle Kohn. Une différence qui repose sur l’accueil de l’altérité au sein de l’enseignement, qui doit s’engager à voir cette différence, à l’inclure. Il n’y a aucune raison objective qu’une école, que l’art contemporain, que les musées restent inaccessibles au plus grand nombre, ce qui reste, malgré tous les processus dits de démocratisation, encore trop vrai. Ici, une tâche majeure d’ouverture reste à accomplir. « Tout ce qui est bon vient de la culture populaire, et tous les textes importants s’y rapportent d’une manière ou d’une autre », aimait à dire un ami exégète de la musique populaire. Il y a peut-être ici une voie à suivre.
*
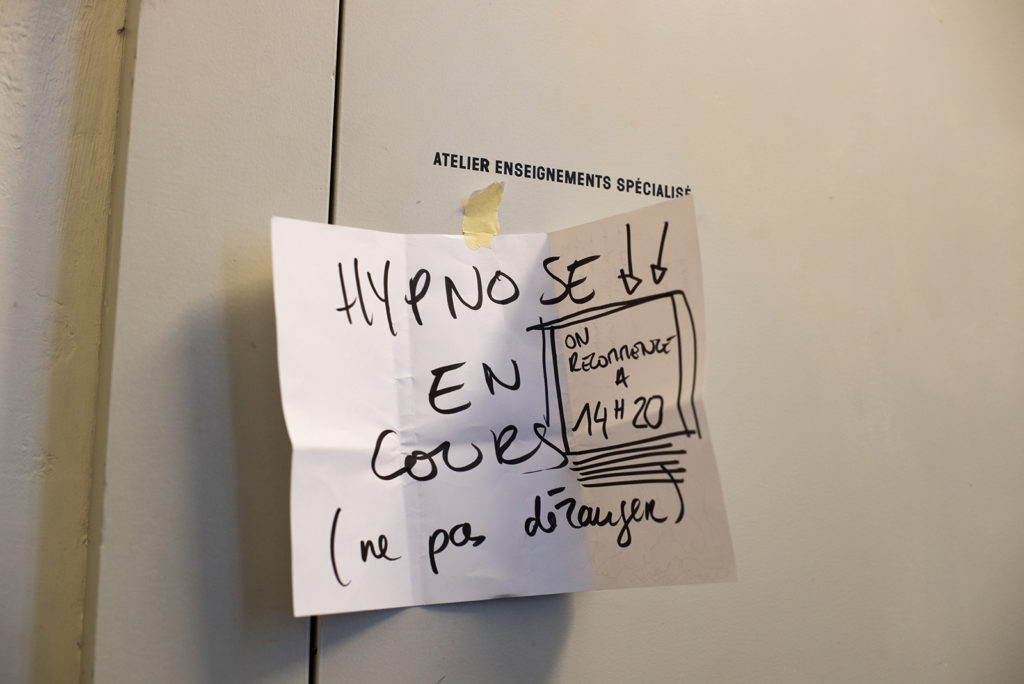
Si les pratiques artistiques d’aujourd’hui dessinent un espace dont les contours ne cessent de s’étendre, incluant, de la manière la plus accueillante, un ensemble de pratiques toujours plus large – au point que certains penseurs, tel Thierry de Duve, affirment que l’art contemporain, c’est « n’importe quoi », non pas au sens que ce n’est rien, bien au contraire, mais que l’art est potentiellement tout, tout ce dont l’artiste fait œuvre – l’enseignement par le milieu ne peut faire l’économie de cette ouverture et de cette diversité intrinsèques. Dans une « écologie pédagogique » réussie, l’art est enseigné selon un principe botanique : les artistes font œuvre de tout, de toute image, matière, ou idée, ou même pour certains, de rien, d’un rien philosophique, scientifique, voire métaphysique, tout comme les plantes, qui créent de la vie à partir de toute terre, air ou eau, partout, en tout temps. Cela fait longtemps que certains enseignants appliquent librement des méthodes qui consistent à parler avec leurs étudiants de tout sauf de l’art, ramenant le dehors de la pratique à l’intérieur de l’école pour, à travers un subtil jeu de miroirs, évoquer dans leurs conversations les choses les plus profondes et les plus intimes par le biais toujours plus inventif de références à la musique, au cinéma, au football, à la vie quotidienne, sensibles à la difficulté pour certains de mettre des mots sur des désirs, des inquiétudes, des idées trop intimes, trop intenses. Selon cette perspective inclusive, curieuse, non hiérarchisante, l’enseignement au sein d’un milieu connecté à l’océan de la culture contemporaine multiplie les points de vue et les lieux d’énonciation, les figures d’identification. La diversité des positions esthétiques, politiques et des économies des artistes enseignants est l’une des clés de la mise en œuvre d’un environnement au sein duquel les enseignés sont à même de formuler, pas à pas, dans la contradiction, parfois le hasard, le doute, leur propre point de vue, sans que les options ne leur soient dictées. Le milieu est cet espace ou de façon fragmentaire, la parole diverse, la multiplicité des sollicitations et des regards, voire la mésinterprétation devient le moteur d’une émancipation, d’un point de vue propre, et critique.
*
Dans un entretien au sujet de l’enseignement, Roland Barthes émet l’hypothèse que jusqu’à la fin du XIXe siècle, la littérature, ou l’histoire de la littérature – nous pourrions dire aujourd’hui l’histoire de l’art, des arts, de la culture – constituait une mathesis, autrement dit un ensemble de savoirs clos, fini, qu’il convenait d’apprendre pour se repérer dans un espace défini, institué. Alors que les limites de ce champ sont aujourd’hui ouvertes, en apparence infinies, planétaires, en reconfiguration constante, que les domaines du savoir sont devenus pluriels, interconnectés, sans autonomie, l’histoire est visualisée comme une matière tressée, tissée, à l’image d’une étendue, un textile, un tissu – en anglais fabric, et ce terme ajoute à la dimension manufacturée de la matière du savoir – un plan sans limite, avec ses pliures, ses zones d’ombre, ses dimensions parallèles, dont l’objet est d’être lu, interprété. Contre le « spécialisme », l’enseignement par le milieu refuse la manière dont la spécialisation académique, née avec l’invention du corporatisme universitaire au Moyen Âge, a sans cesse tenté de brider la volonté de savoir, les excès de curiosité, à travers une visée moraliste engagée dans le châtiment intellectuel du savoir planétaire, encyclopédique, multidisciplinaire des Anciens. L’école d’art autorise l’inscription dans cette tradition, peut-être semi-imaginaire, peut-être semi-réelle, qui imagine elle-même qu’on comprend mieux l’art en lisant de l’anthropologie, en parlant d’astronomie, ou de critique musicale. Le but de l’analyse par le milieu est donc de suivre, avec attention, avec cette attention microscopique, amoureuse du détail, qui caractérise l’étude barthésienne, la circulation des objets pris dans des systèmes de relations complexes. Cet espace de pensée mobile autorise une méthode spécifique et caractéristique, par ailleurs, d’un rapport au savoir qui implique, pour reprendre une distinction chère à Gilles Deleuze et Félix Guattari, non pas d’observer des phénomènes à distance, mais plutôt de suivre des flux, repérer des singularités, accompagner des variations « en cheminant sur elles ». L’enseignement par le milieu, à l’instar de l’enseignement de Roland Barthes (qui prenait la forme d’un séminaire), est un espace anomique, c’est à dire sans pouvoir. Ou plutôt, dans cette forme d’enseignement, la manière dont les corps sont co-présents, dont les relations entre les participants sont organisées, dont l’affect, les désirs, la liberté sont pris en compte, le pouvoir y est réparti autrement, il y est mis en commun, et distribué collectivement. L’autorité y est partagée, dans la circulation de la parole, et le rôle de l’enseignant est de créer les conditions du maintien de ce flux de pensées, d’idées, de contradictions qui permettent de faire advenir quelque chose d’imprévu. À travers un processus d’interprétation, bien connu des personnes qui pratiquent l’art de la conversation artistique, nourrie d’associations, une idée en amenant une autre, et encore une autre, la fin de la conversation – par ailleurs potentiellement infinie, en tous cas toujours inachevée – n’ayant plus de rapport avec le début, le cercle pédagogique a pour fonction de produire un « autre texte » à partir des textes tressés dans l’histoire, un texte encore inconnu des participants, mais aussi de l’enseignant lui-même.
*

L’anthropologue Pierre Clastres, qui a étudié l’organisation politique des sociétés dites sans État, explorant ainsi la manière dont certains groupes ont pu inventer d’autres formes de relations au-delà, ou en deçà de la manière dont nos propres sociétés à État sont organisées, explique la manière dont la parole est distribuée dans certaines sociétés dites « primitives ». À l’opposé de notre monde fondé sur la séparation, où la parole est confisquée par les puissants, à ceux qui sont autorisés à parler, où le discours est confié aux personnes de pouvoir, comme dans un monde inversé, le chef, dans ces sociétés autres, écrit-il, y est le membre qui dispose du moins de pouvoir ; son devoir est de parler, continûment, mais pas nécessairement d’être écouté ; son pouvoir est isolé dans la parole, que Clastres théorise comme « l’opposé de la violence. » « Le devoir de parole du chef, ce flux constant de parole vide qu’il doit à la tribu, c’est sa dette infinie, la garantie qui interdit à l’homme de parole de devenir homme de pouvoir. » Dans l’enseignement par le milieu, la parole a un rôle prépondérant, on pourrait même dire que l’enseignement s’organise presque exclusivement autour de la parole. Non pas qu’on y parle sans cesse – le silence peut y être aussi important que la voix, il peut être éloquent, partagé, on peut parler et ne pas être compris, voire même ne pas être écouté, on peut rester silencieux, ensemble, et regarder, écouter autre chose, comme le silence – mais c’est autour de la parole que la pédagogie s’organise. Mais il ne s’agit pas ici d’une parole de chef, pour reprendre les mots de Clastres, mais d’un tout autre type de parole : on n’y donne pas des ordres, pour que l’autre suive notre point de vue ; on pose des questions, qui n’ont parfois pas de réponse, on se pose des questions, à soi-même, et mutuellement ; on ne donne pas des conseils ; on raconte des histoires ; on n’impose pas un point de vue, un jugement ; on met en relation. La beauté de cette parole est d’être souvent de basse intensité, elle éclaire parfois, lorsque la conversation fonctionne à plein, des zones inattendues du travail, voire même le dehors du travail, un ailleurs, qui nous ramène, par le biais de cette boucle magique de l’échange et de l’interprétation, au centre des choses. Elle peut aussi ne pas fonctionner, et c’est là toute l’autre magie de la parole, qui peut opérer aussi dans le non-dialogue, et produire des effets, des effets, simplement différents.
*
Si l’école est un milieu, elle est aussi au milieu, elle pousse, comme les herbes de Gilles Deleuze, « entre » d’autres choses. Noam Chomsky, dans son manifeste au sujet de L’Éducation humaniste rappelle qu’au mieux la moitié de ce que nous apprenons nous est transmis à l’école. Le reste nous est inculqué à l’extérieur, dans notre famille, au contact de nos amis, par l’expérience, dans la vie. Cette information troublante pour toute personne passionnée par l’enseignement peut aider à relativiser le rôle de l’institution pédagogique, tout comme elle révèle les inégalités sociales intolérables face à l’éducation. Pour autant, elle pointe aussi la nécessité de penser l’école en lien avec l’espace social au sein duquel elle existe et sans lequel elle ne peut, en un sens, pas se développer. Si l’école d’art est nécessairement un espace ouvert, en tant qu’elle s’articule sur des relations avec le monde, qu’il soit emporté avec lui par les enseignants depuis le monde extérieur, ou que le monde – et notamment le monde de l’art – entre dans l’école par différents biais – qui peuvent aller des alliances avec ce qu’on appelle la scène, aux partenariats institutionnels, en passant par le « how-to » ou « kit de survie » pédagogique pour le futur des étudiants dans le monde réel – elle est aussi un espace qui se construit face à une société dans tous ses aspects, donc dans une certaine mesure potentiellement en opposition à un certain nombre de phénomènes par rapport auxquels il est nécessaire de prendre position. La puissance de l’enseignement par le milieu réside ainsi dans sa capacité à agir en relation avec les forces qui régissent d’un côté l’espace de la production à l’issue des formations qu’il dispense, et avec la société plus largement. L’ouverture de l’école au « milieu » est donc un processus à double détente, qui implique de s’interroger sur les objectifs de cet accueil, au sein de la sphère pédagogique, des acteurs et des réseaux professionnels auxquels ils sont liés. L’enseignement par le milieu, en ce sens, est pris dans une tension qui peut être des plus efficaces, mais aussi ambiguës, en tant qu’il institue un état de fait face auquel toute la distance critique est requise, tout en autorisant une critique de ce milieu, et la possible transformation, contamination de celui-ci par les acteurs formés dans l’école. Il reflète par ailleurs la fluidité des engagements politiques contemporains, que le système de l’art incarne de manière particulièrement cruciale aujourd’hui.
*

S’il existe une forme qui puisse représenter spatialement l’enseignement par le milieu, c’est certainement celle du jardin enclos : espace extérieur ouvert à l’environnement, il est aussi enclos, et protégé des éléments. Il autorise la création d’un milieu, d’une atmosphère, d’un climat. En fonction des partis pris botaniques, il peut être organisé ou chaotique, il est avant tout un cosmos, voire un « chaosmos », un monde ou la diversité, l’interpénétration des éléments qui y croissent, l’équilibre précaire de leur agencement sont les principes premiers d’organisation. Si la métaphore organique est évidemment un lieu commun de l’éducation, et de l’éducation artistique en particulier, la théorie du milieu développée au début des années 1970 par Humberto Maturana et Francisco Varela nous permet de complexifier ce que notre jardin pédagogique comporte de potentialités théoriques et pratiques pour aujourd’hui : les deux chercheurs en neurobiologie avaient avancé l’hypothèse que ce qui caractérise le vivant est qu’il « s’autoproduit », ce qu’ils appelaient l’autopoïesis. Selon eux, il n’y a pas d’échange d’information entre les êtres, le milieu étant un vecteur de ces communications entre des entités autonomes. Ainsi, l’enseignement par le milieu est l’espace par excellence de cette manière d’être ensemble et individuellement à la fois, de vivre, de travailler et d’apprendre collectivement tout en préservant l’autonomie de chacun. Car il n’y a pas d’utopie des écoles d’art, au sens de lieu séparé, imaginaire, rêvé : on y organise des espaces, des ambiances ; l’enseignement y est le lieu d’une invention de manières de faire, parfois sans modèle préétabli ; on y développe des économies différentes ; on forge des manières concrètes de faire, au travers de formes, d’outils, de rites, qui conditionnent un regard autre, dans un environnement autre, comme dans un monde dans le monde. Comme dans un jardin, tout y est pragmatique, y est affaire de pratique, d’organisation, de mise en œuvre. On y effectue des gestes, et on observe les effets de ces gestes, on en parle. On forme, on entretient, on s’entraîne. On regarde encore, on pense, on rêve. L’atelier, comme le studio du musicien, est un espace dans lequel le monde vient à soi. Il est intéressant d’ailleurs de noter le terme de studio, qui signifie atelier d’artiste en français, évoque à la fois le lieu de travail, mais aussi d’étude, tout comme un lieu de vie de dimension réduite, minimale, une économie de moyens, une forme d’intimité. Mais cette intimité nécessaire à l’équilibre du milieu, que seule autorise la clôture, est sans cesse menacée par les vents du monde alentour, et il est nécessaire de toujours s’assurer que cette autonomie, cette protection poreuse, mais essentielle, soit toujours bien en place. Car seule l’intimité autorise cet équilibre entre le travail et la vie qu’une école permet, que le milieu favorise, qu’il transcende, en un sens, en une forme qui peut, si elle bien pratiquée, être une des plus belles manières de faire de l’art.
*

Il y a une dizaine d’années, alors que je voyageais souvent, pour parfois de longues durées et des destinations lointaines, j’avais éprouvé, souvent au bout d’un certain temps loin de chez moi, ce sentiment de plénitude lié à la distance, comme une sorte d’anesthésie. J’aimais cette sensation de n’être nulle part, et la liberté mêlée de dépendance à l’hospitalité des autres, qui me procurait comme l’effet d’une drogue douce. Je pense aujourd’hui à cette période de ma vie comme à une forme de transe liée au déplacement continu et qui produisait en moi la joie étrange de me sentir chez moi, en quelque sorte n’importe où, ou plutôt partout où j’étais transitoirement invité à vivre et travailler. Aujourd’hui, alors que je fais l’expérience de l’entre-deux depuis ma séparation d’avec la personne avec laquelle je vivais depuis dix ans et que je me suis installé à l’étranger, mon regard a changé. À l’utopie du nomadisme d’il y a dix ans s’est substituée celle d’exister au milieu des choses, entre plusieurs mondes. À partir de fragments de ces espaces, je construis un autre univers. J’ai rencontré l’amour. Des fois, lorsque je me réveille le matin, je ne sais pas où je suis.
*
Il y a quelques mois, j’avais été invité à écrire un texte pour les besoins d’un livre sur l’enseignement de la théorie dans les écoles d’art. J’avais alors accepté avec enthousiasme l’idée de tenter d’écrire sur ma pratique, et je pensais avoir un nombre important d’idées à communiquer à ce sujet, tout en me réjouissant de pouvoir les synthétiser dans un essai qui me semblait assez aisé à produire. Pour une raison qui me restait alors inconnue à l’époque, je n’ai jamais réussi à finir ce texte. Aujourd’hui, les raisons de cet abandon me semblent plus claires. S’il m’a toujours été aussi difficile de mettre en forme une théorie de l’enseignement artistique, au point que j’ai depuis plusieurs années toujours été contraint de trouver des biais détournés pour parler de ma pratique, que ce soit sous la forme de notes éparses, de lettres, d’entretiens imaginaires, de prose, c’est qu’enseigner dans une école d’art repose sur une certaine idée de la fluidité, sur des processus insaisissables qu’il m’a toujours semblé difficile à fixer dans une quelconque théorie, sur une forme d’éternel recommencement. Écrire sur l’enseignement, lorsque l’on aime vraiment cela, c’est aussi difficile que d’écrire sur l’amour.
*
De ce constat découle la nécessité de répondre à l’engagement d’un penseur comme Walter Benjamin qui passa une grande partie de sa vie intellectuelle, envers et contre nombre de ses détracteurs, à refuser l’interprétation pour privilégier une méthode que l’on pourrait appeler constellationnelle : à travers ses écrits dans lesquels les ellipses, la distance par rapport à l’analyse, l’ascèse méthodologique de la disposition de points dans un espace non reliés, on trouverait un modèle de pensée d’un système d’enseignement, de conversation, de questions sans réponses qui ouvrent un espace pour que le sens se déploie, se déplie, et croisse par le milieu. Ce texte s’est ainsi autorisé quelques ellipses. L’apprentissage, tel que j’ai pu le pratiquer, me semble être profondément lié à une forme de disponibilité à cette différence, à cette ouverture à l’expérience qui induit que le discours bute sur un sentiment de non-nécessité à produire une quelconque généralité. Et l’expérience m’a montré que la dimension hasardeuse de la transmission place la situation d’enseignement dans une relation fragmentaire au savoir, que ces notes essaient de refléter. J’ai donc opté pour une forme qui associe elle-même des fragments, collectés au fil de huit années de travail au sein de la HEAD – Genève, un peu comme on ferait une exposition, ou un cours si on est un curateur qui aime la logique du montage.
*
Invité à donner un séminaire à la Cooper Union à New York à la fin des années 1970, Paul Thek avait imaginé de commencer de s’adresser aux étudiants par le biais d’un long questionnaire dont je reproduis ici un fragment. Ce texte, qui est à la fois un manifeste pédagogique sous la forme de questions, et dont les réponses doivent être données, ou pas, par les étudiants, est aussi un poème lyrique, moderne, enflammé, une déclaration d’amour à l’art et aux formes de vie, aux attitudes qu’il autorise. Il est une manière de créer de manière subjective, engagée, courageuse, un climat de confiance au sein de la classe, confiance qui permette cette interpénétration de la vie d’artiste, d’enseignant, et d’être humain que son œuvre induisait, et qu’une école d’art peut préserver encore aujourd’hui, malgré la puissance de toutes les forces d’académisation, les visées néo-conservatrices, le pouvoir de l’économie libérale qui se fondent sur la séparation entre les êtres.
Ce texte, qui est aussi une lettre que l’artiste s’adresse à lui-même est une manière de s’interroger sur sa propre position, son économie radicale, collective, transgressive, incertaine, inspirée, qui l’a mené à faire exister dans le monde parmi les projets le plus ambitieux, intimes et poétiques de notre temps, pour ensuite le faire chavirer, œuvrer dans la solitude et la précarité, la maladie. Il est un appel à créer du commun, un environnement en miroir de la manière dont son œuvre disparate, insaisissable, est devenue aujourd’hui une matrice partagée, et l’une des sources d’inspiration majeures de notre génération. Mais ces Teaching notes, sous-titrées 4-dimensional design, sont avant tout une méditation sur ce que représente le fait d’être artiste, avec toute l’intensité, la générosité et l’excès, la sensibilité extrême, la fragilité cristalline et la force vitale, indestructible, qui en constituent le pendant.
*
What is eternity ? What is love ? What is art ? What is a symbol ? What is religion ? What is psychology ?
Who are your role models ?
Who is the person closest to you at the moment ?
Who is the person physically closest to you at the moment ?
What in your life is the greatest source of pleasure ?
How do you know you like someone ?
How do you know that someone is interested in you ?
How do you know that you are happy, sad, nervous, bored ?
What does this school need ? This room ? You ? This city ? This country ?
What is an abstraction ?
What is a mystery religion ?
What would it be like if you behaved with absolute power ?
Redesign a rainbow.
Make a French-curved rainbow.
Design a labyrinth dedicated to Freud, using his photos and his writings.
Design a torah.
Design a monstrance.
Illustrate the Godhead.
Add a station to the cross.
Design an abstract monument to Uncle Tom.
…
Make a paperdoll of yourself.
L’auteur remercie Ambroise Tièche pour sa relecture.
Crédit cover: Guillaume Dénervaud, installation, HEAD – Genève, Boulevard Helvétique, 2014. Photographie : © HEAD – Genève



