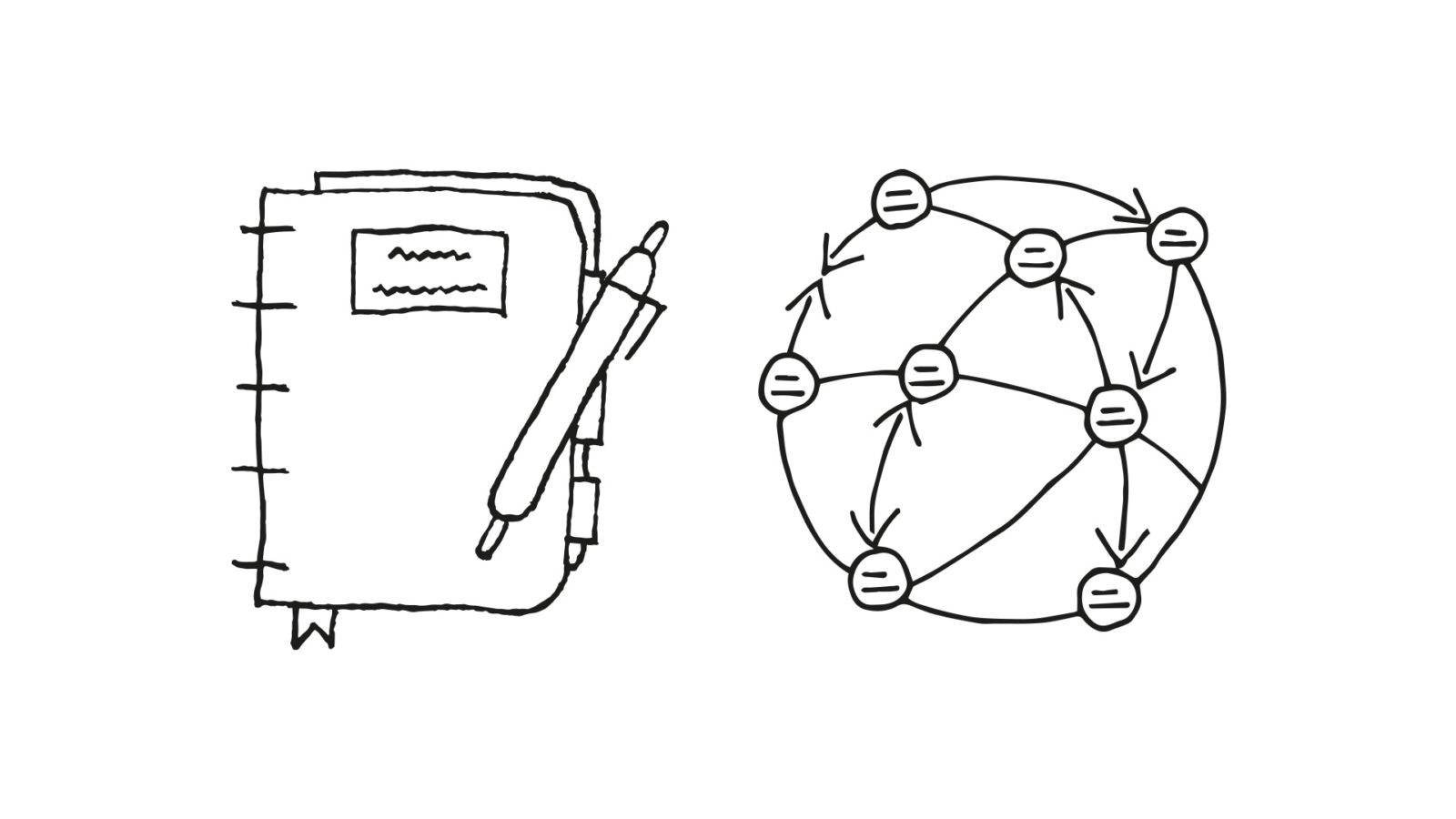Text
Sylvain Menétrey : Tu es directement concernée, et même partie prenante dans l’un des objets d’étude de ta thèse, puisque tu es l’une des cofondatrices de bermuda, un lieu de vie, de fabrication artistique et de résidence d’artistes que les artistes Maxime Bondu et Guillaume Robert, la commissaire d’expositions Bénédicte Le Pimpec, l’ingénieur informatique Julien Griffit et toi, avez auto-construit à Sergy dans l’Ain en collaboration avec l’architecte Thomas Mouillon, de l’agence ACTM. Au-delà de ce lien immédiat, quelles ont été les motivations qui t’ont conduite à te lancer dans une thèse sur les formes d’habitat alternatif des artistes ?
Mathilde Chénin : J’ai un lointain passé de squatteuse. J’ai en effet vécu dans un certain nombre de maisons occupées entre 2001 et 2004 en France, aux Pays-Bas et en Espagne. Depuis lors, la question du pouvoir transformateur et émancipateur des formes de vie est au cœur de mes préoccupations.
Durant les vingt dernières années, j’ai assisté, notamment en ville, à la captation et à la neutralisation par le capitalisme créatif des usages, des pratiques, des esthétiques, et d’une grande partie du lexique, qui étaient, à ce moment-là, au cœur de ma révolte. Je pense, par exemple, aux termes participation ou convivialité, qui ont aujourd’hui largement intégré la sémantique néo-libérale. De la même manière, tout ce qui constituait des espaces autres, au début des années 2000, des espaces hétérotopiques à proprement parler (les hacklabs, les friches, et ce que l’on a appelé en France voisine les Nouveaux Territoires de l’art), et qui émergeaient pour beaucoup depuis des pratiques libertaires et autogestionnaires, ont quant à eux été intégrés aux logiques de l’urbanisme transitoire, qui font aujourd’hui rimer créativité, convivialité ou participation avec rentabilité économique. À tel point que fabriquer des tiers-lieux s’enseigne aujourd’hui à l’université, et que l’on est en droit de se demander ce qu’il en est du potentiel disruptif de toutes ces pratiques spatiales et communautaires.
Donc, au départ de la recherche, il y avait le désir de questionner ce qui m’apparaissait comme une impasse des politiques pré-figuratives, comme un échec des initiatives qui entendent transformer les quotidiens depuis le lieu même de l’habité. La rencontre avec le courant de la sociologie pragmatique, auquel Luca Pattaroni, qui a suivi ma thèse, contribue par ses recherches, m’a permis de mettre des analyses, des concepts et des mots sur le désarroi que je ressentais alors face à cette impasse.
Entre mes années de squat et aujourd’hui, j’ai étudié à l’E.N.S.A.P.C., l’école d’art de Cergy-Pontoise, où j’ai pu faire l’expérience de la démarche collective par un autre biais, celui, cette fois, du travail créateur, et de ce que cela veut dire de mettre des œuvres, et plus modestement, des formes dans le monde. Au fil de ce parcours, une des interrogations qui s’est imposée, et qui me travaille toujours, concerne la question de l’agentivité de l’art : que peut-il faire, que peut-il produire dans le tissu social, alors qu’encore une fois, comme l’ont montré Jean-Louis Genard, ou Misha Piraud à sa suite, la créativité, ou pour le dire autrement la production de différence, sont devenus des moteurs du capitalisme néo-libéral.
Ma thèse a pris pied au cœur de ce qui m’apparaissait comme une double impasse, comme un échec de la rencontre de la vie et de l’art à transformer nos formes de vie.
Plus avant, le travail de la thèse a ainsi été un moment pour interroger de manière critique ce que le régime de monstration propre au champ de l’art fait aux choses du monde, qu’il expose et met en représentation. Je pense ici à toutes ces expositions où l’on vient rejouer ce qu’Isabelle Stengers appelle des pratiques, ou des usages, mineurs. Et, pour reprendre les termes de Marie-Anne Lanavère, ancienne directrice du Centre International d’Art et du Paysage de Vassivière, ce que l’art fait aux choses du monde relève largement d’un mouvement extractiviste, mouvement qui les fragilise en les arrachant au contexte qui les rend au contraire agissantes.
Ma thèse a ainsi pris pied au cœur de ce qui m’apparaissait comme une double impasse, comme un échec de la rencontre de la vie et de l’art à transformer nos formes de vie, à permettre l’advenue d’une vie bonne, comme le dit Judith Butler. J’ai donc cherché à mettre au jour les formes de commun qui se composent au croisement de deux activités qui sont d’une part habiter ensemble, et de l’autre créer — ou pour le dire autrement, travailler en artiste — afin de voir si leur rencontre autorisait l’invention d’autres formes de vivre-ensemble. Pour cela, je me suis intéressée à la trajectoire de trois lieux de vie et de travail artistique en France : bermuda, la Déviation et Moly-Sabata, ce dernier, assez éloigné des deux autres, n’occupant au final que peu de place dans ma thèse.
S.M. : Qu’est-ce qui t’a conduite à privilégier les cas de bermuda et La Déviation plutôt que celui de Moly-Sabata ?
M.C. : La principale raison tient au fait que pendant une grande partie de la recherche, j’avais choisi d’observer les trajectoires des trois lieux en question, parce ce qu’ils proposaient tous les trois, mais de façon différente, des temps de résidence artistique, la résidence étant cette expérience très singulière que font les artistes de tous mediums et de toutes pratiques, d’habiter quelque part pour les besoins de leur activité créatrice. La résidence me semblait donc un poste d’observation privilégié de ce qui se compose, en termes de commun, au croisement de l’activité qui consiste à habiter, et celle qui consiste à créer.
Mais, au fil de mes terrains en observation participante à Moly-Sabata et à La Déviation, force a été de constater que mon postulat de départ n’était pas le bon. D’une part, parce que la résidence artistique ne se prête pas au tissage d’un lien et d’un attachement habitant : en plus d’être temporaire, ce dispositif d’aide à la création se pense, en effet, généralement sous les auspices de la mobilité. Il vise à ouvrir de nouveaux horizons pour les artistes qui en bénéficient, à les dé-payser, et les extraire, à proprement parler, de leur quotidien, de leur routine, et de ce qui est perçu comme un empêtrement. Pour ma part, c’était justement à cet endroit-là, celui de la routine et de l’empêtrement avec le quotidien qu’il m’intéressait de regarder ce que l’art pouvait produire. Donc, ça n’allait pas.
D’autre part, la focale de la résidence ne me permettait pas non plus d’observer la composition du commun à l’endroit même où se croisent habiter ensemble et créer. Il est vrai qu’au départ, en 1927, Moly-Sabata était un phalanstère d’artistes, créé par le peintre cubiste Albert Gleizes. Le lieu devait leur permettre de retrouver une vie simple, et en accord avec les préceptes esthétiques et spirituels de Gleizes. La petite communauté initiale vivait cette utopie de manière assez radicale, en partageant non seulement les espaces, mais également les tâches liées au travail de subsistance, les biens, les revenus, etc.

À titre d’exemple, la trajectoire d’Anne Dangar qui y a vécu jusqu’à sa mort est passionnante : fervente disciple de Gleizes, et alors qu’elle est déjà une peintre établie en Australie, elle quitte tout pour rejoindre Moly-Sabata en 1930, dans l’espoir de se consacrer à la peinture. Une fois sur place, Gleizes l’enjoint à abandonner cette pratique au profit de la poterie, activité ô combien plus rémunératrice qui lui permettra de survivre à Sablons. Et c’est ce qu’elle fera, non sans difficulté, mais avec abnégation. D’un côté, Moly-Sabata raconte, ainsi, l’histoire de personnes pétries de croyances esthétiques, utopiques et spirituelles, qui se retrouvent, pour vivre en cohérence avec ces visées, à cultiver des légumes et à vivre dans une grande précarité. De l’autre, Moly-Sabata raconte aussi l’histoire de toute une tradition d’art d’usage, dont on pourrait dire, de manière un peu anachronique, qu’il est foncièrement militant : un art, qui ne se destine pas à être exposé dans les galeries, mais à peupler les tables de cuisine et les armoires des habitant·es du village, pour embellir, et donc améliorer, le quotidien.
Aujourd’hui, cela dit, le projet de résidence de Moly-Sabata, plutôt classique dans le champ de l’art contemporain, n’est plus mu par une visée communautaire. Il donne lieu à tout un tas de très belles sociabilités, des apéros, des dîners, des amitiés, des rencontres, etc., mais les artistes invité·es ne produisent pas pour autant ensemble, sur le terrain du travail créateur, quelque chose qui dépasserait leurs pratiques ou leurs intérêts individuels.
Du côté de La Déviation — qui est, je ne l’ai pas encore précisé, un lieu de recherche et d’expérimentations artistiques situé dans les anciens ateliers mécaniques de la cimenterie Lafarge, à l’Estaque au nord de Marseille —, je me suis progressivement rendue compte que les questions de cohabitation liées au contexte de la résidence n’étaient pas spécifiques au fait que les personnes travaillent, ici, en artiste.

Que ce soit en foyer d’étudiant·es, dans un squat politique ou une cohabitation d’artistes, habiter ensemble, c’est compliqué. Dans le sillage des travaux de Laurent Thévenot, toute une génération de chercheurs·euses, se sont intéressé·es à la question de la cohabitation. Marc Breviglieri, Luca Pattaroni et Joan Stavo-Debauge, pour ne citer qu’eux, ont par exemple étudié au début des années 2000 la manière dont se déployait le vivre-ensemble dans un certain nombre de squats genevois, décrivant avec soin et finesse ce qui se trame dans les salles communes ou les cuisines collectives. Ils ont mis en évidence que la cohabitation est toujours un régime de et en tension, le lieu d’importantes négociations.
Dans le cas du squat par exemple, où le lieu de vie est aussi celui de la lutte politique, et alors que la lutte donc, vient se tisser dans les moindres interstices du quotidien, l’impératif d’hospitalité, de convivialité et de participation entre souvent en friction, en tension avec le fait que, pour certain·es, le lieu partagé, ouvert et collectif est aussi le lieu du chez-soi, c’est-à-dire un lieu qui doit leur permettre une forme de repli, de clôture, d’éloignement de l’espace public. Bref, ce qui se passait dans la cuisine commune de La Déviation n’avait donc rien à envier à ce qui se passait dans celle du 27Rousseau ou du Clos Voltaire, mais ne pointait pas pour autant vers ce qui serait une spécificité d’habiter ensemble et en artiste.
Donc, au fur et à mesure de la recherche, le format de la résidence faisait surgir tout un tas d’obstacles à ce que je souhaitais observer. C’est au moment de l’écriture de la thèse, qui a coïncidé avec la fin du chantier en auto-construction des ateliers bermuda, et avec mon installation pérenne sur place, avec compagnon et enfant, que mon regard s’est déplacé de la résidence au chantier. Je me suis alors rendue compte qu’il y avait, à bermuda et à La Déviation, une même expérience singulière : celle d’artistes qui passent le plus clair de leur temps à fabriquer, à construire, dans le premier sens du terme, leur lieu commun de vie et de travail, et c’est ce qui a dès lors retenu mon attention. C’est aussi à ce moment-là que Moly-Sabata, où il n’y a pas plus de projet communautaire que de chantier de construction, s’est trouvé excentré du propos de la thèse.
S.M. : Tu dis qu’il n’y a pas de différence, finalement, entre des plombiers qui cohabitent, et des artistes qui font la même chose. Pourquoi alors t’es-tu intéressée plus particulièrement aux artistes-qui-vivent-et-travaillent-ensemble, hormis le fait que c’est donc une expérience qui t’est personnelle ?
M.C. : Ma pratique artistique s’intéresse depuis bien avant la thèse aux formes du commun, à la forme que cela fait d’être ensemble. Avant d’entreprendre ce long parcours doctoral, j’avais amorcé un projet de recherche intitulé La maison des artistes, Casa Nostra. Cette sorte de préfiguration de la thèse s’intéressait aux formes du commun que composent, ou non, les artistes plasticien·nes depuis la pratique de l’art qui est la leur. Il me semblait, en effet alors, que les artistes dit·es d’arts visuel peinaient à composer un commun assez consistant pour dépasser leurs intérêts individuels, qui eux, semblaient le plus souvent primer. Ce qui n’était pas le cas du côté des arts vivants, à l’image des intermittent·es, qui formulent des revendications politiques à partir des conditions spécifiques de leur activité créatrice, jusqu’à en étendre la portée à l’ensemble des travailleur·euses précaires.
La thèse a été l’occasion d’approfondir cette question, en reprenant le fil d’un ensemble de travaux de sociologues comme Eve Chiapello, ou encore Pierre-Michel Menger, qui pointent la manière dont, dans le champ contemporain, travailler en artiste, se définir et être reconnu·e comme tel, revient avant tout à se subjectiviser, à devenir sujet en singularité. C’est ainsi parce qu’iels sont radicalement singulier·ères, et en cela irréductibles au commun, que les artistes sont ce qu’iels sont. Cette situation m’intéressait plus largement parce que cette subjectivation en singularité est aujourd’hui loin de ne concerner que les plasticien·nes. Le sociologue Danilo Martucelli parle à cet égard de la société singulariste, afin de souligner la manière dont nous sommes tou·tes enjoint·es à faire preuve ou état de notre propre style.
S.M. : Dans les deux exemples principaux que tu as analysés, bermuda et La Déviation, les occupant·es sont propriétaires du lieu, ce qui n’est pas du tout habituel pour des communautés d’artistes.
M.C. : Oui, c’est très rare en effet, en tout cas en France voisine, où seulement 1% des lieux en commun des artistes sont soumis au régime de la propriété privée, comme l’a montré la sociologue Isabelle Mayaud en 2019. La situation de bermuda et de La Déviation, en plus d’être atypique, est, à cet égard, doublement intéressante. D’une part, parce que les deux lieux échappent ainsi aux logiques de l’urbanisme transitoire, que j’évoquais tout à l’heure, et qui caractérisent la trajectoire d’un nombre incalculable d’initiatives collectives et artistiques, notamment en milieu urbain. Les propriétaires de bâtiments vides ont, en effet, compris qu’iels avaient meilleur temps d’autoriser des collectifs à s’installer, plutôt que de laisser leur bien immobilier se dégrader, sous l’effet du temps, ou de l’occupation non maîtrisée de squatteur·euses. La S.N.C.F. a ainsi tout un parc de lieux en friche, dont l’occupation est gérée par un système d’appel d’offre pour des projets d’occupation temporaire. Les collectifs d’artistes et/ou d’acteur·rices de la vie sociale et culturelle, qui bénéficient de ces dispositifs, s’impliquent énormément pour créer bénévolement des endroits magnifiques, qui vont produire une nouvelle vie de quartier, de la mixité sociale, de la circulation des pratiques, des savoirs, etc., et puis, au terme de la permission d’occuper, soit un à trois ans plus tard, iels sont remercié·es de leurs bons services, et doivent faire place à des projets résidentiels et immobiliers autrement plus lucratifs. Ce qui n’est rien d’autre qu’un processus de gentrification urbaine. En cela, et parce qu’ils ne sont pas soumis à cette tyrannie du temporaire, bermuda et La Déviation sont un peu plus maîtres de leur trajectoire.
La tactique du temporaire se révèle aujourd’hui un piège dans le contexte du capitalisme créatif.
Le régime de propriété collective est d’autre part très intéressant, parce qu’il entre en tension avec l’idée selon laquelle il faudrait, afin de s’émanciper, mais aussi de ”mieux” créer, ne jamais s’attacher à un lieu, ne jamais s’y enraciner, ce qui est parfois le cas quand on devient propriétaire, et que l’on se projette dans la durée à un endroit. Même si la crise éco-systémique que nous traversons remet sur le devant des préoccupations nos manières d’habiter, ou encore l’importance d’atterrir, comme le disait Bruno Latour, la sémantique de l’enracinement véhicule encore largement une coloration conservatrice, potentiellement xénophobe et centrée sur des questions d’identité.
Face à cela, la figure du nomadisme, comme celle du temporaire, ont longtemps prévalu, notamment au début des années 2000, comme des tactiques viables pour faire échec à la réappropriation marchande. Je pense ici par exemple à la Temporary Autonomous Zone d’Hakim Bey. Mais comme je le disais à l’instant, la tactique du temporaire se révèle aujourd’hui un piège dans le contexte du capitalisme créatif, et il était intéressant de pouvoir observer ce que l’inscription dans une durée indéterminée faisait aux lieux et aux collectifs en question ici.
S.M. : Comment bermuda et La Déviation interagissent-elles avec le monde extérieur et comment sont-elles perçues par leurs voisins ou les localités où elles s’installent ?
M.C. : bermuda se trouve à Sergy, dans le Pays de Gex, à quelques kilomètres de la frontière avec le CERN. Ce territoire frontalier est atypique, encore à la fois très rural, mais également marqué par une forte urbanisation résidentielle, par la prégnance des mouvements pendulaires en direction de Genève, ainsi que par une situation foncière très tendue. Dans ce contexte, c’est l’ancien maire, Denis Linglin, qui a rendu le projet possible en nous vendant le terrain, une friche industrielle de la SNCF présente sur la commune et inoccupée depuis 20 ans. Il a tout de suite vu le bénéfice à nous accueillir sur le territoire communal.

Du côté de l’équipe bermuda, même s’il y a une vigilance au fait que nous sommes avant tout un lieu de fabrication artistique, un lieu où des personnes travaillent à proprement parler, et ont donc besoin de ne pas être constamment sollicité·es, il y a dès le départ une volonté d’ouverture. Une ouverture sur le quartier, sur le village, et sur le territoire plus largement. Cela passe tout autant par des relations de bon voisinage, que par des ouvertures publiques lors des sorties de résidence des artistes que nous accueillons ; par ce que l’on appelle les « projets école », qui invitent des artistes, pour qui la question de la transmission est au cœur de la pratique, à mener un projet de création avec les élèves des petites communes alentours ; ou encore par l’accueil que nous faisons maintenant depuis trois ans au festival de La Bâtie. C’est ici une logique de proche en proche qui prime.
Comme je le disais tout à l’heure, La Déviation se trouve, quant à elle, à l’Estaque, un quartier très populaire, même s’il est en train de se gentrifier, dans les hauteurs septentrionales de Marseille. Tout au long de la recherche que j’y ai mené, le rapport au monde extérieur était un grand sujet de débat, notamment à propos de la programmation de leur bar associatif, La Guinguette. Dans ces discussions, venaient se heurter deux idéaux : d’un côté, celui d’une hospitalité radicale et d’un désir politique axé sur l’ouverture au quartier à travers la création d’un lieu convivial, et de l’autre celui d’un lieu qui pourrait se consacrer au travail artistique et à l’émergence de formes exigeantes. Iels ont résolu ce dilemme en ouvrant le lieu en d’autres endroits, notamment ceux qui ont trait à la mutualisation de la subsistance, en tenant par exemple un marché hebdomadaire, ou en inaugurant un fournil participatif, où des membres du collectif et des habitant·es du quartier font du pain ensemble toutes les semaines.
S.M. : Pour en revenir aux chantiers de construction que tu évoquais tout à l’heure, tu disais donc qu’ils ont rapidement pris toute la place pour les artistes impliqué·es, parfois pendant une très longue temporalité. Quand la pratique artistique personnelle doit s’effacer au profit du projet collectif, cela peut être source de frustration j’imagine ?
M.C. : Oui en effet, et bien que les deux chantiers aient été très différents dans leur forme (un chantier de réhabilitation dans le cas de La Déviation, un chantier en auto-construction dans celui de bermuda), ils ont constitué une épreuve de taille pour les deux groupes. La pratique individuelle des personnes impliquées a largement été mise entre parenthèses, au profit de l’activité de bâtisseur·euse, puis de gestionnaire du lieu. Dans ce contexte, les tensions naissent le plus fréquemment du manque d’investissement temporel de certain·es participant·es, et de la sensation d’injustice qui en découle chez celles et ceux qui consentent, quant à elles·eux, à faire passer leur pratique au second plan.
S.M. : Qu’est-ce qui a été mis en place pour résoudre les tensions lors des chantiers ?
MC : Dans un premier temps, à bermuda comme à La Déviation, et comme c’est en réalité assez courant, dès lors que des personnes cherchent à coordonner leur action pour la faire aboutir, les deux collectifs sont passés par la mise en place de forme de comptage et de comptabilité du temps d’implication, afin que chacun·e soit en mesure de pouvoir, à proprement parler, compter les un·es sur les autres. À bermuda, on a aussi proposé à celles·ceux qui étaient dans l’impossibilité de s’impliquer en présence, de compenser ce manquement à l’effort collectif par une participation financière accrue, afin de rémunérer par exemple une tierce personne qui viendrait soutenir l’équipe. Mais cette solution ne s’est pas révélée satisfaisante. Dans notre cas, on a fini par demander à la personne qui s’impliquait moins que les autres de quitter le projet. J’ai, ainsi, consacré une partie de la thèse à décortiquer deux disputes, deux moments de la vie de chacun des collectifs où le chantier et l’épreuve à laquelle il les confronte, viennent fissurer le commun.
Le commun se compose comme une grammaire.
Le moment du désaccord est particulièrement intéressant pour comprendre comment un groupe fait groupe. La sociologie pragmatique en fait un moment crucial d’observation de la mise en commun. Laurent Thévenot, qui fonde cette démarche sociologique avec Luc Boltanski, dans le sillage de leur ouvrage De la justification (1991), met en évidence, à cet égard, que le commun se compose comme une grammaire. Il y a ainsi différentes manières de le composer, et c’est au moment du différend que l’on peut au mieux saisir les logiques propres à chacune de ses grammaires.
Il serait trop long ici de détailler chacune d’entre elles, et ce qu’elles mettent en jeu, mais simplement dire que celle qui m’intéressait le plus, au regard des deux cas que j’observais, se nomme la grammaire d’affinités plurielles à des lieux communs. Cette grammaire qualifie avec justesse ce qui se noue, par exemple, entre des personnes qui, bien qu’iels viennent d’horizon sociaux, économiques ou idéologiques différents, se retrouvent à lutter ensemble pour la sauvegarde d’un parc ou d’une zad.
S.M. : Et donc comment expliques-tu, du côté de bermuda, cet échec à faire tenir le groupe ensemble ?
M.C. : Je crois, et c’est ce que j’ai tenté de démontrer dans la thèse, que cela tient à la spécificité, en termes de mise en commun, de ce que compose le fait de fabriquer ensemble le lieu commun. Passer son temps, quasi quotidiennement, et pendant plus de deux ans et demi, à bâtir ce qui deviendra le lieu où tu vas vivre et travailler, aux côtés d’autres personnes qui sont pareillement engagé·es, et alors même que ces personnes ne sont en rien des professionnel·les du bâtiment, mais sont au contraire plongé·es, par cette activité de fabrication, dans un état exploratoire et dans un rapport hétérodoxe aux gestes et aux techniques dont iels usent pour ce faire, cela crée des liens particuliers entre ces personnes, ainsi qu’un attachement très fort au lieu qui se construit. Cet attachement tient en grande partie à la situation intense de co-présence induite par le chantier, par son caractère parfois très laborieux, répétitif, routinier, ou alors périlleux parfois, quand tu te retrouves soudain à huit mètres du sol avec tes camarades à couvrir la charpente, alors même que tu n’es pas couvreur·euse.

En cela, à bermuda comme à La Déviation, les chantiers ont certes été des épreuves, et des sources de conflit avec les celles·ceux qui ne s’y engageaient pas en présence, mais ils ont également constitué, pour les autres, des moments de cohésion, un liant puissant, qui a permis de souder le collectif. J’ai ainsi rapproché ce que je relevais dans les archives de La Déviation, ou directement au gré de mon expérience sur le chantier de bermuda, de ce que la sociologue Rachel Brahy a qualifié de formes de commun en présence, formes qu’elle observe au sein d’ateliers dits de théâtre-action en Belgique. L’engagement dans l’action n’est certes pas le même lorsqu’un groupe fabrique une pièce de théâtre, et quand il construit un bâtiment, mais ces deux temps de fabrication d’un lieu commun (la pièce de théâtre d’un côté, le lieu de vie et de travail de l’autre) semblaient, néanmoins, donner lieu au même type d’expérience convergente, comme le dit Rachel Brahy.
À partir de sa proposition, et prolongeant en cela une discussion entamée par Laurent Thévenot qui préfère, quant à lui, l’idée d’un engagement et d’une mise en commun en résonance, j’ai avancé l’idée d’un engagement somatique dans l’action, qui me semble qualifier assez justement l’ouverture attentionnelle, qui est celle de ces moments de fabrication où l’on est à la fois disponible, à l’écoute de l’autre, mais aussi plus amplement relié·es à soi-même.
Ainsi, ce qui compose le commun, dans les deux lieux que j’ai observé, n’est pas tant de partager des principes ou valeurs idéologiques, ou une visée esthétique, mais plutôt le fait même de fabriquer ensemble le lieu commun, puis d’en prendre soin, de le maintenir, et donc, selon la perspective résidentielle défendue par Tim Ingold, d’y habiter. Le partage du faire, et son insertion fine dans le maillage du quotidien permet ainsi de tisser une forme de commun en familiarité et en singularité, mais déplace également les pratiques artistiques vers ce que j’ai nommé un art en usage : un art qui ne distingue pas un bien fabriquer, d’un bien faire usage des choses du monde, et qui permet à l’expérience esthétique d’advenir parfois au détour d’un volet.

S.M. : Et à la Déviation ?
M.C. : Dans le cas de La Déviation, c’est la parole, plus que la présence, qui est mise au travail dans les moments de dispute. Comme dans beaucoup de collectifs militants à l’organisation horizontale, cette dernière a, en effet, très vite été conscientisée par ce groupe, qui est très attentif à l’idée selon laquelle parler, nommer les choses, nommer ses ressentis, aide à dissiper les tensions.
Dans le cas de La Déviation, la pratique de la parole collective prend une forme singulière, qui se pense sous les auspices de la parrêsia, le « dire vrai de soi ». Cette notion, qui remonte à la démocratie grecque, renvoie à la capacité du citoyen à interpeller la majorité quand il pense que cette dernière se trompe. Quand Foucault reprend cette notion, il en fait un point central du récit de soi, cette manière qu’ont les individu·es de se rendre transparent·es, de se raconter elles·eux-mêmes, non seulement pour mieux se connaître, mais aussi pour répondre aux logiques des mécanismes disciplinaires.
Le collectif de La Déviation se réapproprie ce terme, pour en faire le moteur de la prise de parole lors des réunions dites de fond. Elles débutent toutes par un tour de parole libre, au cours duquel chacun·e est invité·e à faire état de là où iel en est par rapport au projet, que ce soit sur le terrain personnel, que celui de la manière dont iel conçoit, perçoit, envisage le projet collectif et la forme à lui donner. En cela, la pratique de la parrêsia ne vise pas tant à apaiser les tensions – ce qu’elle ne parvient, d’ailleurs, pas véritablement à faire à La Déviation, dont le groupe a connu beaucoup de reconfigurations –, qu’à faire émerger la forme commune, de l’expression et de la mise en résonance des visions singulières. On peut voir là une belle tentative du collectif de faire commun en singularité.
S.M. : Toutes ces réunions ont été retranscrites et forment une archive conséquente que tu as passé beaucoup de temps à étudier et à valoriser. Quelle mise en forme as-tu effectuée à partir de ces fichiers ?
M.C. : Il y avait, en effet, une matière énorme, plus de 300 comptes rendus de réunions allant de 2015 à 2021. J’ai commencé par tout lire, puis par faire un index comportant la date, la nature du compte-rendu, le nom des participant·es, et les points abordés au cours de la réunion. Il s’agissait en premier lieu de disposer d’un outil de navigation au sein de ces archives, pour ensuite dégager les informations qui m’intéressaient, tout en gardant la trace de la parole individuelle des un·es et des autres. Ces différents temps de lecture et d’analyse ont donné lieu à la réalisation de mind maps, qui permettent de visualiser, de spatialiser toutes ces données et les réflexions auxquelles les archives m’ont conduites.
Ensuite, j’ai écrit un texte intitulé Une certaine histoire de la Déviation, qui donne une version plus facilement lisible et partageable de ces archives. Au terme du travail, j’ai fait don de ces différents outils archivistiques au collectif, avec l’idée que lorsque le temps serait venu pour elles·eux, iels pourraient s’en emparer pour relire, retraverser leur propre histoire, de manière réflexive et critique.
S.M. : Était-ce une des motivations de ta thèse de mettre une pierre à l’édifice ?
M.C. : Oui, j’avais le désir non seulement que ce travail archivistique contribue à une culture des précédents, comme nous y encouragent les auteurs de Micropolitique des groupes. Pour une écologie des pratiques collectives (car faire archive, c’est aussi la volonté de transmettre pour permettre à d’autres d’établir des filiations, de trouver des alliances), mais aussi plus largement, au regard de l’ensemble de la recherche. En décrivant la manière dont ces deux lieux ont de faire lieu, je souhaitais que l’on puisse à nouveau s’autoriser à penser que c’est en s’attelant à fabriquer collectivement et matériellement les lieux dans lesquels nous habitons ensemble, que nous nous ouvrirons la voie à de nouvelles formes de mise en commun.

 Back to summary
Back to summary