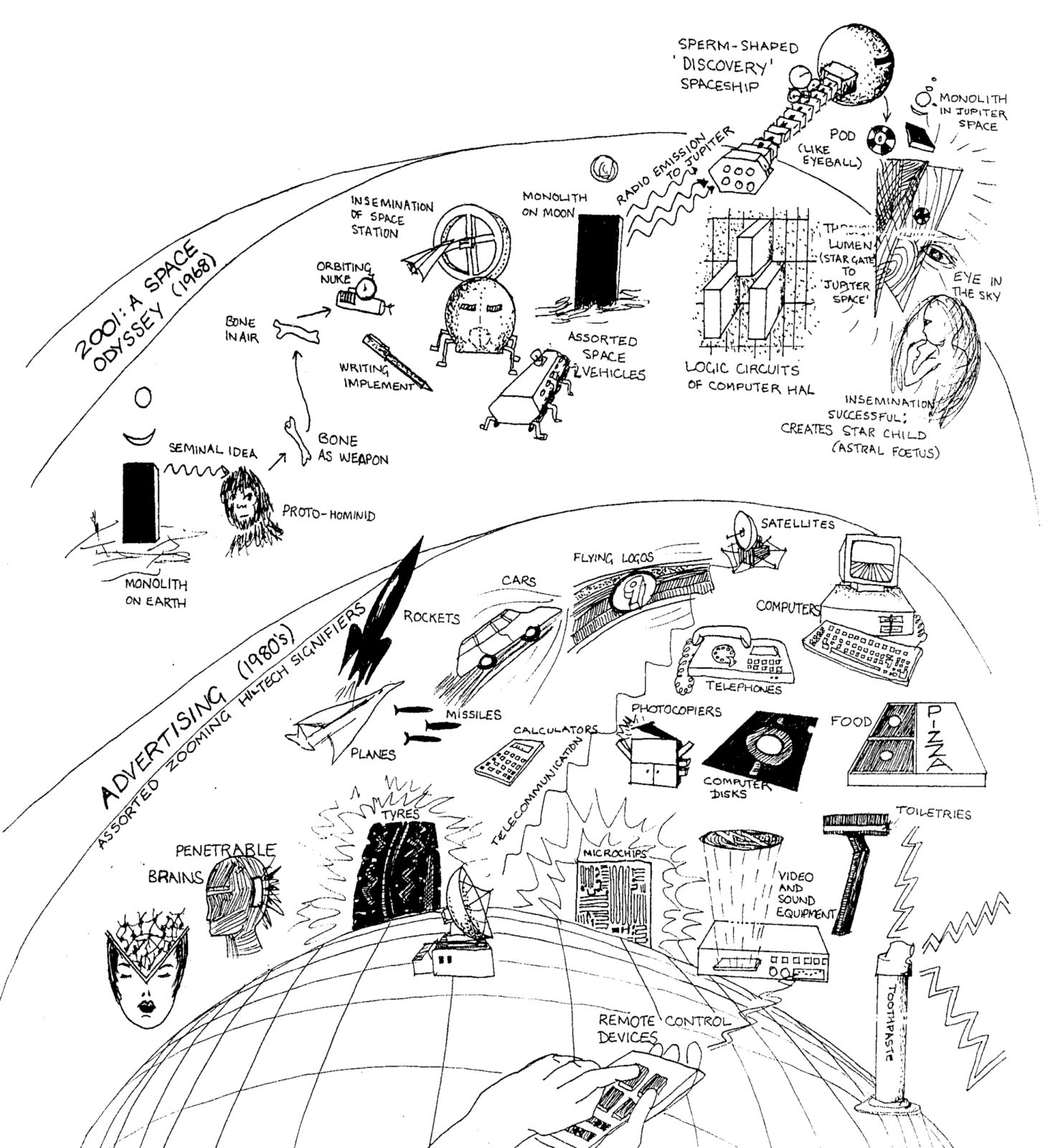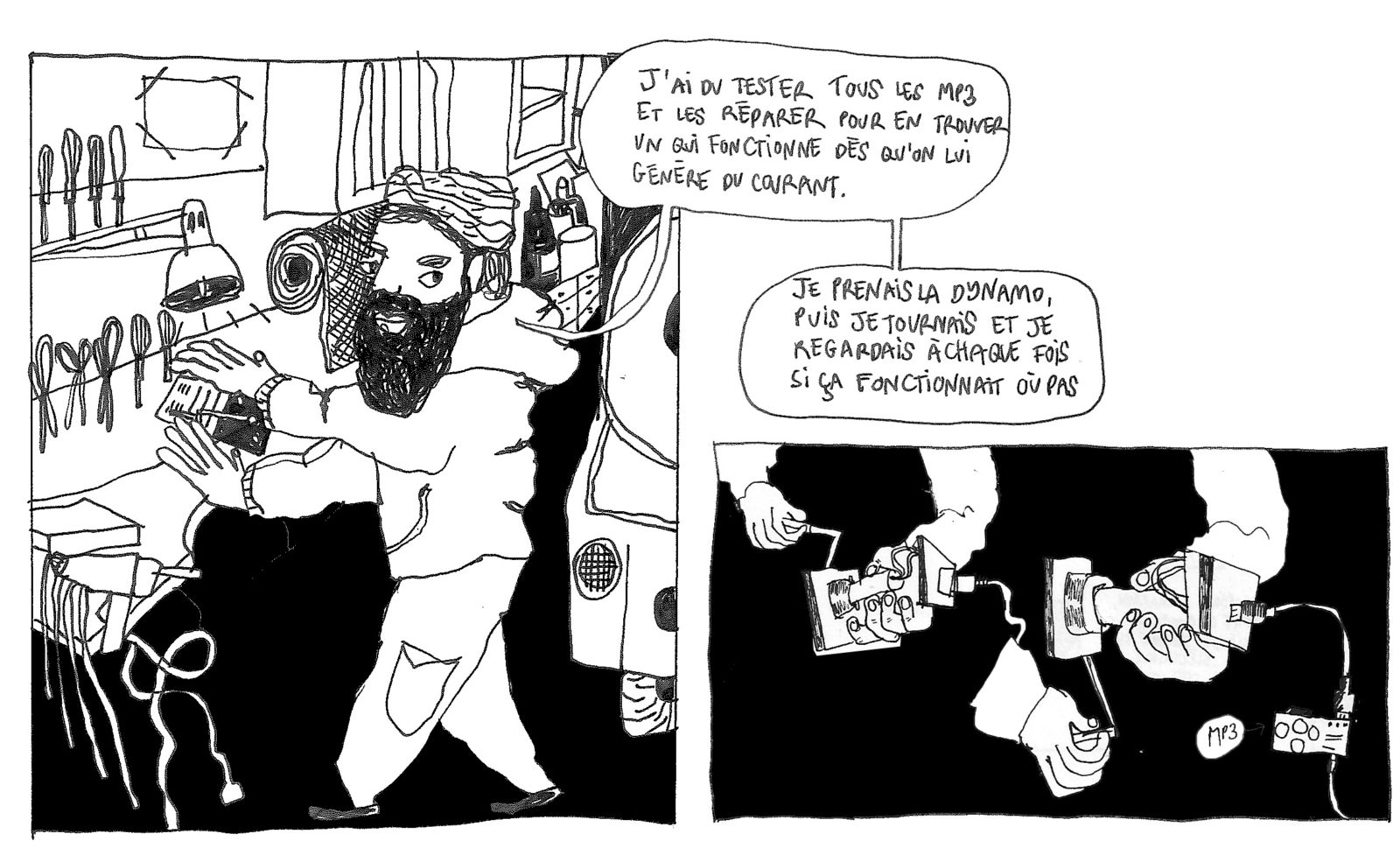Abstract
In recent years, the Photography Pool of HEAD – Genève has organised two transversal workshops in collaboration with CERN, the EPFL’s Biophore and the Geneva Astronomical Observatory. In 2017-2018, the “Figures” workshop led to the publication, Un signal sur un bruit de fond. In 2019-2020, Infiniment infini was the title of both a second publication and the workshop from which it stemmed. Both publications are accessible in PDF in this article. Artist and curator Annette Amberg was invited to bring these two years to a close with a text of her own creation, which we also publish here. In it, Amberg reflects on the place of CERN in culture, also analysing the tensions between technological development – which includes increasingly sophisticated visualisation and representation tools – and the tangible space-time to which human relations are limited.
Text
Infiniment infini (2018–2019)

Ce workshop se confrontait à l’univers des sciences et plus précisément à celui de la physique des particules. Les arts visuels y puisent certains enjeux de réflexion pour questionner la représentation des images : de la particule à l’objet cosmique se joue un rapport d’échelle abyssal. C’est dans ce rapport entre l’infiniment grand et l’infiniment petit que s’opère un processus de réflexion, en lien également avec la technicité du médium photographique. À partir de l‘observation de lieux scientifiques dédiés à la physique des particules et à la cosmologie, les étudiant·e·x·s ont navigué entre prises de vue documentaires, expérimentations au laboratoire argentique (photogrammes), prises de vue en studio et tous types d’usages des outils numériques pour réaliser une publication commune. Le CERN, le Biophore de l’EPFL et l’observatoire astronomique de Genève ont été les trois terrains d’étude à partir desquels les étudiant·e·x·s ont pu travailler la matière photographique.
Intervenant·e·s :
Yvan Alvarez, Grégory Chatonsky, Larisa Dryansky, Stéphanie Gygax, Aurélie Pétrel, Virginie Otth, Rob Van Leijsen
Invité·e·s :
Grégory Chatonsky est un artiste franco-canadien qui s’intéresse aux nouvelles technologies et leur impact sur notre réalité. Il est l’un des pionniers du net art.
Théoricienne et historienne de l’art, Larisa Dryansky a axé ses recherches sur les rapports de la science et de l’art dans l’art américain des années 1960.
Avec les étudiant·e·s d’Arts visuels :
Nicole Boechat, Léo Chadel, Félicie Cortat, Léonard Debieux, Marion Dubey, Sara Fiechter, Oskar Fougeirol, Jimmy Garcia, Arnaud Grand Chauvin, Alexandre Moura Ferreira, Zoé Molnar, Delphine Moyard, Mélissa Ruiz
Avec les étudiant·e·s de Communication visuelle :
Mélissa Biondo, Nicolas Calame, Céline Nidegger
Avec les étudiant·e·s de master Espace & Communication :
Samy Bouard-Cart, Claire Terraillon
Un signal sur un bruit de fond (2017–2018)

Cette publication est le résultat d’un travail réalisé par un groupe d’étudiant·e·s en Arts Visuels des options Appropriation et Information/Fiction de la HEAD – Genève en février 2018 à l’initiative de Stéphanie Gygax, Virginie Otth et Aurélie Pétrel, assistées de Prune Simon-Vermot.
Les étudiant·e·s sont parti·e·s d’un processus d’association: Image/légende/texte du livre FIG. d’Adam Bromberg & Oliver Chanarin, publié par Steidl en 2007. Une réflexion sur le CERN a été proposée comme sujet. Après une présentation des activités du CERN sur place par Bertrand Nicquevert (ingénieur supérieur, département d’ingénierie, CERN), et un égarement volontaire dans le labyrinthe des bureaux et la fantasmagorie scientifique de chacun, le groupe a fait une visite dans le tunnel qui contient le LHC (Large Hadron Collider), le fameux accélérateur de particules. La première étape était une expérience d’immersion directe dans les lieux physiques et mentaux de cet illustre centre de recherche scientifique. Un processus d’observation, une collection de données que les étudiant·e·s ont réalisée principalement avec le médium photographique. Ensuite, iels ont expérimenté divers processus d’association, effectué une sélection d’images pour chacune des propositions, élaboré des stratégies de travail en commun, cherché à visualiser l’invisible, imaginé des parallèles entre l’art et la science, inventé des protocoles poétiques, formulé des hypothèses artistiques…
Certain·e·s ont joué avec le paradoxe de la légende qui contredit l’image, d’autres ont inventé des récits de science-fiction, d’autres se sont attaché·e·s à des détails formels qui évoquent la métaphysique, d’autres encore ont utilisé l’humour ou l’absurde pour tenter de figurer le CERN. La troisième étape était de trouver une cohérence à cette publication, un début et une fin, une narration qui fasse sens avec toutes ces propositions. La logique interne du macro au micro, de l’infiniment grand à l’infiniment petit tout en se jouant des formes et des projections a été adoptée.
Avec les étudiant·e·s d’Arts visuels, option Information/Fiction & Appropriation, dans le cadre d’une semaine de tous les possibles intitulée Figures
Intervenant·e·s :
Stéphanie Gygax, Dr. Bertrand Nicquevert, Virginie Otth, Aurélie Pétrel, Prune Simon-Vermot, Joël Vacheron
Invité·e·s :
Dr. Bertrand Nicquevert est ingénieur et intervenant au CERN.
Joël Vacheron est un sociologue et journaliste indépendant basé à Lisbonne. Il s’intéresse aux flux et aux nouvelles technologies et leur impact sur la narration et notre quotidien.
Avec les étudiant·e·s d’Arts visuels :
Anaïs Balmont, Reisa Boksi, Carine Chrast, Lucie Cellier, Théodore De Felice, Alizée Gex, Elisa Gleize, Léonard Gremaud, Jonathan Levy, Joëlle Meylan, Dayla Mischler, Delphine Moyard, Louise Monteduro, Alice Perritaz, Anouk Reichenback,
Gloria Sandona, Natacha Todeschini, Agathe Wolff
Strong Interaction
Un texte d’Annette Amberg
Depuis la gare de Genève, nous sommes monté·e·s sur la colline en tram, le conservateur chinois en voyage de recherche et moi-même, en direction des collines enneigées du Jura, là où – à cheval entre la Suisse et la France – se cache la plus grande machine du monde à 100 mètres sous terre. Depuis sa fondation en 1954, l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN), sise à Meyrin, s’adonne à la recherche fondamentale en physique des particules, afin de percer le mystère de la création et de la nature de l’univers bien avant la formation des planètes et des étoiles. L’accélérateur de particules le plus grand et le plus performant du monde, le Grand collisionneur de hadrons (LHC), avec ses quatre détecteurs de particules ATLAS, ALICE, CMS et LHCb, est en service depuis 2008. L’accélérateur de particules est constitué d’un tunnel circulaire de 27 km, où les protons sont accélérés à une vitesse avoisinant celle de la lumière avant d’entrer en collision.
En 1955, au Moma à New York, Edward Steichen a organisé la légendaire exposition de photos The Family of Man. À l’issue des guerres mondiales dévastatrices, cette dernière est née de l’aspiration à démontrer les points communs de l’homme sous toutes ses facettes – un portrait universel de l’humanité. Des photographies des quatre coins du monde y ont été exposées dans des catégories telles que la naissance, le travail, la famille et la mort. Elle est ainsi devenue l’exposition de photos la plus visitée du monde (et a aussi été critiquée comme outil de propagande américain pendant la guerre froide). La couverture intérieure du catalogue de l’exposition reproduit une photo grand format d’un nuage cosmique, prise par l’Observatoire de Lick, en Californie. Le début du catalogue de l’exposition, dédié à la représentation de la conditio humana, commence par l’origine de toute vie dans l’espace. Parallèlement, on peut y voir une référence à l’étroite relation entre l’astronomie et le développement de la photographie. En effet, l’invention du daguerréotype, en 1839, sonne également l’avènement de l’ère de l’astrophotographie. Ce qui devait auparavant être noté et comparé suite à l’observation complexe et laborieuse du ciel à l’œil nu (avec le télescope), pouvait désormais être consigné, évalué et comparé sur des plaques de cuivre argentées, et plus tard sur papier. L’essor de la photographie s’est avéré fulgurant, puisque l’astronome amateur et professeur de médecine John William Draper est parvenu, en 1840, à prendre la première photo détaillée de la surface de la lune avec un temps d’exposition de 20 minutes. Les procédés photographiques ont été affinés continuellement, assurant une résolution toujours plus élevée dans la représentation des corps célestes. En 1898, l’astrophysicien James Edward Keeler a inspiré plusieurs générations d’astronomes avec des prises de vues extrêmement précises de la nébuleuse d’Orion. À noter que ses photos ont été prises à l’Observatoire de Lick – ce qui pourrait signifier qu’il est également l’auteur de la photo du catalogue The Family of Man (l’auteur n’étant pas mentionné).

Dans mon imaginaire, le CERN était le lieu de culte de la science et de la technologie, faisant la part belle à la matière noire et au Big Bang, aux professeurs fous et aux superordinateurs – véritable ouroboros technologique dans les entrailles de la terre. Il était une source d’inspiration pour les romans et s’est mué en un lieu de pèlerinage pour les rappeurs et les vedettes de cinéma. Le mythe du CERN est si vaste que la mise en service du LHC a suscité un véritable tollé : on craignait que les expériences des physiciens permettraient effectivement de percer les mystères de l’espace, si bien qu’il s’ensuivrait un trou noir qui engloutirait tout. (La fin du continuum espace-temps ; on songe au tandem père-fille malmené flottant vers le trou noir à bord d’un vaisseau spatial dans le film dystopique High Life de Claire Denis). Nous devions voir cet endroit de nos propres yeux.
À l’exception du Globe de la science et de l’innovation, une sphère en bois qui fait office de lieu événementiel, le site ressemble de prime abord à une aire industrielle ordinaire. Le tout est composé de bâtiments en béton quelconques dotés de grandes portes, d’escaliers métalliques et de diverses entrées, entourés d’une clôture. Y avait-il aussi des caméras de surveillance? Je ne me souviens pas d’en avoir vu. Nous avons obtenu accès au détecteur ATLAS, qui mesure les particules créées lors de la collision des protons (notamment les muons, les quarks et les fameux bosons de Higgs, découverts en 2012). Étant donné que le détecteur est en révision jusqu’en 2025, nous avons été autorisé·e·s à prendre l’ascenseur jusqu’à la machine. Si le casque de protection rouge était davantage pour la forme, l’idée même de descendre si profond sous terre me nouait l’estomac. D’innombrables affiches tentaient de nous faire comprendre ce qui se passe sur place: «Expecting the Unknown: The Unknown, Dark Matter, Mass, Antimatter» ou «Atlas Experiment: Atlas explores… where extra dimensions may lurk… to find the truly fundamental». Le tout dans une tonalité et une présentation empruntées aux affiches de films de science-fiction. Un lieu où la plupart des faits sont occultés et se déroulent dans les entrailles de la terre, dans un environnement radioactif, à des températures plus glaciales que dans l’espace, où les données recueillies sont archivées et analysées à l’aide de superordinateurs aux quatre coins du monde – cela tient déjà de la fiction.

L’espace a fait partie de notre réalité pendant des siècles, sans jamais être accessible physiquement pour autant. Il s’agissait d’un point de repère, mais également d’une surface de projection pour notre imaginaire. La conquête spatiale a eu lieu parallèlement au développement des appareils technologiques et à la façon dont l’être humain imaginait voyager dans l’espace – que ce soit une cabine équipée de feux d’artifice chez Cyrano de Bergerac ou un gigantesque boulet de canon chez Jules Verne. Quand la Russie est parvenue à mettre un satellite (Spoutnik 1) en orbite terrestre pour la première fois, le 4 octobre 1957, l’Occident a été pris de surprise – le coup d’envoi de la course à l’espace était donné. En observant le ciel nocturne aujourd’hui, nous continuons à y voir un théâtre convoité pour des projets ambitieux comme StarLink, qui fait partie de la mission spatiale privée SpaceX d’Elon Musk. Il aspire à lancer plusieurs milliers de satellites en orbite pour assurer un accès Internet rapide et infaillible à l’échelle planétaire. La colonisation de Mars et d’autres planètes constitue un autre objectif de l’entreprise.
En sortant de l’ascenseur, nous avons été frappé·e·s par la pléthore de câbles dans toutes les variations et couleurs: ils se faufilent des salles de serveurs, collent aux murs tels des tentacules et nous accompagnent dans les couloirs étroits menant au détecteur. Ce dernier est doté d’un système d’aimants en forme d’anneau – avec encore plus de câbles, de fils et de plaques. En amont du détecteur se dresse un puits circulaire – d’une hauteur de cinq étages, comme je l’ai lu plus tard – auquel mènent de gros tuyaux. J’étais là, bouche bée, sans rien y comprendre. J’ai cependant pris conscience de l’énormité de l’appareil, de cette machine scintillante devant laquelle on ne pouvait faire autre chose que prendre un selfie. Plus tard, j’ai également lu que l’ATLAS dispose de 100 millions de canaux électroniques, à l’instar d’un appareil photo numérique, mais que contrairement à ce dernier, ils sont lus 40 millions de fois par seconde, ce qui génère une quantité de données énorme. Autant de superlatifs pour rendre visibles les particules les plus infimes dont est composé le monde. J’ai songé à la construction d’une cathédrale: se plonger à l’aveuglette dans un projet universel qui sera perpétué au fil des générations – le tout au nom de la foi (ou de la science, en l’occurrence).
Afin de garantir un flux d’information automatique et sans accroc entre les scientifiques, le Britannique Tim Berners-Lee a développé le World Wide Web au CERN, à la fin des années 1980. «The World Wide Web is a wide-area hypermedia information retrieval initiative aiming to give universal access to a large universe of documents», peut-on ainsi lire en guise de préambule sur le premier site Web (info.cern.ch). Le 30 avril 1993, le CERN a rendu le logiciel accessible au public, en renonçant consciemment au paiement de redevances ou au brevetage. La première photo chargée sur un site Web pour le plaisir date déjà de 1991 et illustre le groupe de musique Les Horribles Cernettes, composé des scientifiques du CERN Michele Muller, Lynn Veronneau, Angela Higney et Colette Reilly. Dans leurs chansons, elles thématisent avec ironie (aujourd’hui encore, d’ailleurs, dans une formation modifiée) l’antimatière, les quarks et leur jalousie du collisionneur. Tim Berners-Lee a chargé l’image de la taille d’un timbre-poste en 1991, un processus qui prenait alors quelques minutes dès l’ouverture du site Web. Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis : le Web 2.0 a permis l’interconnexion de l’appareil photo, d’Internet et du téléphone portable et les gens sont devenus des producteurs qui génèrent et partagent des contenus en temps réel – le fameux « user generated content ». De nos jours, ces photos constituent des « conversational images » dont l’utilité se limite à la circulation sur les réseaux sociaux. Le caractère éphémère de ces images contraste fortement avec la longévité du contenu chargé. En effet, les données restent consultables en permanence. Outre les images qui nous sont proposées par un algorithme, il en existe ainsi d’innombrables cachées.
Après la visite de l’expérience ATLAS, nous nous sommes retrouvés à la cantine, un lieu à l’agencement pragmatique où tout le monde paraissait se connaître. Des scientifiques du monde entier effectuent ici des périodes de recherche, voire désormais des artistes, dans le cadre du programme « Arts for CERN ». En parcourant ensuite les couloirs des bureaux, nous avons été interpellé·e·s par la vétusté et la décrépitude des locaux. Des ventilateurs aux fenêtres, des piles de papier dans les bureaux, des tableaux noirs avec des croquis à la craie. Le contraste par rapport à la technologie dernier cri utilisée pour les expériences était saisissant, presque digne d’un cliché. Peut-être est-ce dû au fait que le contexte de la simulation du Big Bang met inévitablement en exergue la banalité du quotidien dans lequel nous travaillons, mangeons, faisons la fête, dormons et garons nos voitures.

L’une des photos les plus fondamentales pour la compréhension de la planète Terre et de son caractère éphémère a été prise depuis l’espace : «Le lever de Terre», documenté par William Anders en 1968 (First Earthrise Seen by Human Eyes, Apollo 8, 1968), est devenu l’emblème de l’ère de la foi dans le progrès, mais également du mouvement climatique. C’est alors que la Terre est réellement devenue une planète. En 1968, Stewart Brand, qui a également inventé le terme « ordinateur personnel », a utilisé l’une des images satellites de la Terre pour la couverture du premier numéro du Whole Earth Catalogue, le magazine californien de la culture alternative, une alliance entre férus de la nature et adorateurs de technologie – une sorte d’ancêtre de Google qui mettait en réseau (il s’agissait d’un guide de vie, d’une encyclopédie, d’un recueil d’opinions et de recommandations des lecteur·rice·s sur des sujets comme les synthétiseurs électroniques ou les accouchements par sages-femmes) les personnes qui aspiraient à un avenir différent.
Aujourd’hui, j’ai lu dans le journal que le « Rover Zhurong », nommé d’après le dieu chinois du feu, s’est posé sur Mars dans la région d’Utopia Planitia, où il va à présent se réveiller pour procéder à des travaux et des examens pendant au moins trois mois. J’envoie un e-mail au conservateur chinois pour lui demander comment il va. Entre notre visite au CERN et aujourd’hui, il y a eu la pandémie. Reste à savoir si le vaccin Covid-19 « Spoutnik V » entamera une nouvelle ère au même titre que le satellite éponyme jadis.
Ce texte traduit de l’allemand par Mediamixtre – Lugano vient clore deux workshops transversaux dans le cadre des Semaines de tous les possibles de la HEAD – Genève organisés par le Pool Photographie qui s’intéressait à l’univers des sciences. Il s’intègre dans la publication Infiniment infini qui suit un premier livre intitulé Un signal sur un bruit de fond.